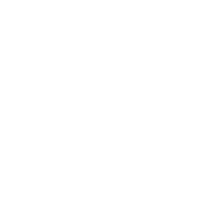Un soir, un livre 2018
|
11 janvier 2019
18 h. - Chez Agnès, Autun Autour de :
Hôtel Waldheim de François Vallejo
(Babelio; 2018)
Ci-dessous le compte rendu des échanges
lors des différentes réunions, proposé par Jeanne Bem
|
|
||||
|
Mercredi 14 novembre 2018
Nous étions hier dans la belle maison d'Elisabeth - merci à elle pour son accueil.
Plusieurs s'étaient excusé(e)s et nous n'étions que huit pour discuter du roman fascinant d'Hubert Haddad, "Casting sauvage". La discussion a été animée, on a eu des sentiments parfois différents. Tout le monde a été d'accord sur la qualité littéraire. Ce sont de petites phrases ciselées, des images très belles et justes, en particulier pour évoquer Paris, son asphalte, ses ciels, la Seine: un bel accomplissement stylistique, un peu dans la tradition du surréalisme. C'est même tellement bien écrit, si constamment, que c'est presque trop dense, c'est comme un poème en prose sur 150 pages. En même temps, paradoxalement, cela reste léger et aéré. Autre accord, sur la composition. Le romancier suit plusieurs fils qu'il entrelace étroitement. Il part de Damya qui a été blessée à une terrasse le 13 novembre 2015, et cette donnée justifie: qu'elle ne danse plus; qu'elle marche dans Paris; qu'elle a trouvé ce job bizarre, le casting à partir de rencontres de rue; qu'elle est hantée par le garçon qui lui avait donné RV à la terrasse; qu'elle fait d'autres rencontres qui ouvrent d'autres possibles; que le casting l'amène à rencontrer toute la misère du pavé parisien, mais avec les immigrés à l'arrière-plan seulement (eux sont de vrais figurants, puisqu'elle n'a pas le droit de les recruter!); et que nous ayons à la fin un spectacle de chorégraphie et le tournage d'une séquence de film à la gare de l'Est. C'est très habilement fait, mais là encore, on peut trouver que c'est trop riche. La scène de tournage suscite le malaise. On est projeté en arrière, en juin 1945 - et puis non! c'est juste un film, tout est faux. Haddad réunit dans la même histoire deux catastrophes lourdes - les attentats de Paris et la Shoah. Une catastrophe aurait suffi, me semble-t-il. Et puis, le 13 novembre est trop près pour qu'on le fictionnalise (ce n'était pas l'avis de tout le monde); quant aux déportés dans la séquence de tournage, quant à ce parti pris du réalisateur du film de raconter (de fictionnaliser) la Shoah en images hyper réalistes, c'est également discutable (enfin c'est que je pense, et je n'étais pas toute seule à le penser). La question de la légitimité des images de la Shoah et des fictions sur la Shoah a été abordée par Georges Didi-Huberman et Claude Lanzmann. Donc un livre attachant mais suscitant des sentiments mêlés. Un livre qui contient de grandes beautés et beaucoup de tristesse. Damya fait de belles rencontres, l'acrobate par exemple, et la lumière de Paris est magnifique, mais nous sommes comme les survivants précaires d'on ne sait quoi. |
 |
||||
|
Lundi, 8 octobre 2018
Nous étions hier soir chez Nicole Neyrat - merci à elle pour son accueil! Il y avait plusieurs personnes excusées, nous étions treize en tout.
La discussion sur le livre de Christophe Boltanski, "Le guetteur", a été animée, intéressante et sympathique. Deux ou trois participants ont eu du mal à entrer dans ce texte. En partie peut-être à cause de sa construction qui mélange les strates temporelles. Mais est-ce que nous ne vivons pas toujours à la fois dans notre présent et dans notre passé? Dans l'ensemble, le livre a été plutôt bien reçu. Personnellement je me suis trouvée particulièrement en phase avec le personnage principal: la mère du narrateur est de ma génération, j'étais étudiante au Quartier latin en 1960 et j'ai habité aux Olympiades dans le 13e! Mais je vais plutôt essayer de cerner les qualités littéraires du livre de Boltanski, en m'appuyant sur ce qui a été dit dans la discussion. "Le guetteur" est le récit d'une quête ou même d'une enquête à la manière d'un roman policier. Le récit est écrit par un fils porté par un désir obscur, contrarié, inassouvi: comprendre qui était sa mère, remédier à la difficulté qu'ils ont eue à se parler quand elle était encore en vie. Le début est classique, le narrateur et sa soeur liquident l'appartement de leur mère. Ils jettent presque tout mais Christophe garde quelques chemises et carnets qui témoignent que sur le tard sa mère elle-même essayait d'écrire des romans policiers. L'un de ces projets portait comme titre "Le guetteur". Il sait que dans sa jeunesse elle a eu une phase, qui est restée voilée, de militantisme de gauche pendant la fin de la guerre d'Algérie. Il se demande si l'espèce de déchéance dans laquelle elle a fini par tomber n'a pas un rapport avec cette époque. Qui avait guetté qui? c'est ce qui intrigue le fils. En tant que militante clandestine, elle avait été surveillée par la police; elle-même avait peut-être dû faire pour le compte du FLN une filature dangereuse qui aurait pu mener au meurtre d'un homme. Dans ses dernières années elle avait développé une paranoïa, "on" la guettait. Maintenant c'est son fils qui commet cette intrusion dans le passé, le vécu, les émotions de sa mère. C'est lui le guetteur. |
 |
||||
| Cela fait un récit complexe et esthétiquement réussi. L'auteur arrive à concilier opacité et petits spots de lumière, incertitude généralisée et précision documentaire (reconstitution des décors, des rues, des vêtements, des voitures, ou encore évocation convaincante du fonctionnement du FLN en France - et puis il y a toute cette atmosphère de guerre civile larvée, à Paris, vers 1960-1962). Des visages émergent et disparaissent, des noms passent, recouverts par des homonymes ou des pseudonymes, des silhouettes vagues sont entraperçues sur des photos, des témoignages se dérobent... Le dernier tiers du livre installe une poésie à la manière de Modiano, sauf que Boltanski n'a pas la nostalgie d'un monde disparu. La couleur du livre est plutôt la tristesse : il cherchait la vérité, la vérité est un leurre. Il ne reste que cette tentative, le texte, et l'entrelacs de ces regards croisés. Et quand même, une sorte de lettre d'amour posthume du fils à sa mère. | |||||
|
Mardi 3 septembre 2018
Pour cette réunion de rentrée, nous étions quatorze hier soir chez Nicole Grémeaux (merci à elle pour son accueil, et à tout le monde pour les bonnes choses sur la table) et la discussion a été très animée à propos du roman de Goliarda Sapienza, "Rendez-vous à Positano" (écrit en 1984, publié en Italie en 2015).
Tout le monde a aimé le livre. Certains ont été plus envoûtés que d'autres. On a passé en revue la vie de l'écrivaine, son oeuvre (un participant avait lu les 700 pages de "L'art de la joie"), les beautés de la côte amalfitaine, l'Italie des années 50 et 60, mais on a surtout parlé de l'art de la romancière: comment elle a conçu cette figure de rêve, Erica, comment la narratrice (qui est plus ou moins elle-même) s'efface devant cette amie mystérieuse qui la fascine, comment le lecteur est amené à accepter même les côtés sombres d'Erica, et puis les belles évocations du paysage de Positano avec les variations de la lumière, le côté cinématographique du roman, et encore cette petite société de gens simples, les habitants du village, qui savent tout des visiteurs mais qui les entourent et les choient dans la plus grande discrétion... Car, a-t-on dit, Positano est comme un rêve mi-aristocratique mi-"communiste", une petite société égalitaire où la lutte des classes n'existerait pas, où il n'y aurait plus des maîtres et des serviteurs, il n'y aurait plus que des rencontres intenses ainsi que les délicates fluctuations, certes tragiques parfois, des sentiments et des destins... |
 |
||||
|
Lundi 25 juin 2018 Sur les sept présents, il y en avait deux pas très emballés par le livre, mais les autres l'avaient apprécié, certains avec enthousiasme. |
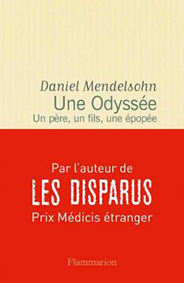 |
||||
| Il y a beaucoup de trouvailles aussi au niveau des détails. Prenons par exemple le lit, l'objet "lit" : nous avons le lit d'Ulysse, qui fonctionne comme un signe de reconnaissance dans le poème. Mais chez les Mendelsohn, il est mentalement associé au lit que le père du narrateur avait confectionné pour lui jadis - il avait utilisé une porte! Et voilà que le dernier mot du vieux père avant de mourir est "porte"! (Ce détail s'enrichit si l'on pense que c'est une allusion au fameux mot sur lequel se termine le film d'Orson Welles "Citizen Kane". Au terme de l'enquête sur la question de savoir qui était vraiment le redoutable magnat, apparaît le mot qui semble contenir mystérieusement la vérité de Kane: "Rosebud". Or ce "bouton de rose" était simplement la marque de la luge sur laquelle il s'amusait quand il était petit.) La figure du père dans "Une Odyssée" a beaucoup de facettes, elle évolue au fil du récit, elle s'approfondit, et cette sorte d'enquête sur "qui était vraiment le père de Daniel?" en dit beaucoup, mais avec légèreté et pudeur, et même avec humour, sur les ambivalences des relations parents-enfants, et leur part irrémédiable d'énigme. Un lecteur, une lectrice peut se projeter dans ce livre: par exemple une lectrice peut y trouver, par transposition, matière à penser sur les rapports mère-fille... L'imprévu est à l'origine même de "Une Odyssée": le professeur Mendelsohn donnait un séminaire, son vieux père retraité a eu l'idée d'y assister, et à partir de là s'entrelace une suite d'évènements divers, amusants ou émouvants, qui poussent Daniel à écrire, et qui interrogent en nous "l'humain" - comment était-on "homme" au temps des dieux et des héros? et aujourd'hui? Et il y passe, par éclairs, un peu de cette vérité "humaine", aussi insaisissable qu'est inabordable l'île d'Ithaque |
|||||
|
Vendredi 27 avril 2018
Nous étions une dizaine dans la belle maison de Colette (merci à elle pour son accueil!) pour discuter du livre de François Garde, "Marcher à Kerguelen".
La discussion a été animée, le livre semble-t-il a intéressé mais pas suscité d'adhésion véritable. Plusieurs y ont retrouvé les difficultés et les émotions éprouvées en randonnée. Le caractère extrême de l'aventure a été reconnu, ainsi que la nécessité de faire équipe: marcher en solitaire à Kerguelen est impossible. Mais on a été intrigué par le peu de place laissé à l'élément humain, aux trois compagnons. Le regard de l'auteur (qui est romancier par ailleurs) est plutôt géographique, géologique, météorologique. Des roches, des matières sont évoquées, quelques panoramas, mais il est difficile de visualiser les paysages de Kerguelen. Plusieurs ont même regretté qu'il n'y ait pas de photographies - alors que deux des randonneurs étaient photographes. La qualité du style de François Garde a été unanimement reconnue. Le caractère "répétitif" a rebuté certains lecteurs / lectrices. Effectivement, il y a une monotonie inhérente au projet, chacun des 25 jours est identique et cependant différent. |
 |
||||
|
Je voudrais en quelques mots donner une lecture un peu différente, peut-être plus "littéraire", en m'appuyant d'ailleurs sur des éléments de la discussion.
S'il y avait eu des photographies, ce serait un autre livre, un "beau livre", mais banal. De toute façon, l'immersion dans les conditions extrêmes de cette expérience ne passerait pas dans des photos. Il y a tous ces toponymes "français", souvent bretons, qui ponctuent la marche: l'auteur, qui n'a que l'écriture à sa disposition, s'approprie Kerguelen par l'énumération des noms de baies, de plages, de falaises, de presqu'îles, de rivières, de glaciers, de pics... S'il avait tout décrit, la marche aurait été sérieusement ralentie (la marche de la lecture)! Il a recours aussi à la métaphore, particulièrement à la musique: belle évocation du vent, ou encore du rythme de la marche. L'élément humain est présent mais en creux: le groupe des quatre s'incarne dans ses quatre "voix". Ou encore ils s'inscrivent dans l'espace à parcourir: à la file, ou par deux, ou tous déployés en ligne, ou encore les uns en bas, les autres sur une ligne plus haute... François Garde est quelqu'un de réservé et de discret, il ne veut pas parler pour les autres. Il a déjà du mal à parler pour lui: peu de confidences, quelques méditations brèves, quelques phrases-sentences. Tout l'intime est transféré dans le dehors, dans les anfractuosités de cette terre australe hostile, éternelle, secrète, cette approximation de l'Eden perdu. L'auteur est parti à la recherche de lui-même (on ne voyage que pour se trouver) mais il ne nous dit pas vraiment s'il y est parvenu. Le livre vaut par nos attentes déçues. Nous n'y trouvons pas de pittoresque, pas d'humour, pas de choses à "regarder", peu de couleurs, rarement des animaux, pratiquement pas de psychologie. De même que les randonneurs ont enlevé de leurs sacs à dos tout ce qui est inutile, de même l'auteur se débarrasse des accessoires usuels de ce type de récit de voyage. A sa façon, rien que par son style et ses choix narratifs, François Garde a réussi à approcher d'une expérience: l'ascèse. |
|||||
|
Vendredi 16 mars 2018 Cinq ou six personnes étaient excusées, mais nous étions quand même douze à Valouze! |
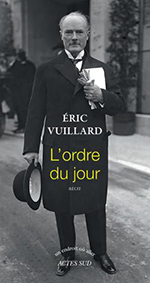 |
||||
| Narrativement, le récit est construit pas à pas, et avance le long de quelques dates sélectionnées, avec de courtes anticipations du procès de Nuremberg, ou d'autres qui nous emmènent jusque dans les années 1950. En 1958, des ayant droit américains de déportés juifs exploités par Krupp (mais ce "Konzern" n'était pas le seul, loin de là, comme Vuillard le souligne) demandent des réparations, et la firme les traite avec une radinerie grossière. Cela fait penser à l'excellent livre de Géraldine Schwarz, "Les Amnésiques", Flammarion, 2017. "L'ordre du jour" est un livre très actuel. Les grands groupes des années 1930 sont toujours là. Nous achetons leurs produits. Mais comme on l'a dit dans la discussion, si les dangers sont similaires, le monde a changé, on ne peut plus s'en prendre à des messieurs en costume cravate à la tête des multinationales, les pouvoirs qui nous menacent sont multiformes et encore plus insaisissables qu'avant. On sent une grande colère chez cet écrivain et cinéaste né en 1968. "L'ordre du jour" a été écrit pour nous secouer. |
|||||