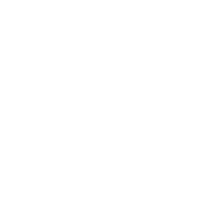Recherche
Les textes des lauréats
Contenu en cours d'élaboration.
Niveau 6e
Sujet 1
Valentin GARNIER (Valivalou)
Collège Maurice Clavel - Avallon
Valentin GARNIER (Valivalou)
Collège Maurice Clavel - Avallon
Voyage sur le Nil
C'était un matin, sur les bords du quai à attendre que nous embarquions dans cette felouque pour ce voyage que j'attendais avec impatience. Déjà, nous étions sous un soleil prometteur et la chaleur commençait à se faire étouffante.
Une fois avoir embarqué, moi Caïus, le petit homme de la ville, j'étais prêt à partir pour une belle aventure et découvrir des paysages magnifiques. Je partis à la rencontre de gens nouveaux.
Une fois avoir embarqué, moi Caïus, le petit homme de la ville, j'étais prêt à partir pour une belle aventure et découvrir des paysages magnifiques. Je partis à la rencontre de gens nouveaux.
Une fois sorti du port, ce qui m'impressionna le plus, ce fut la beauté de cette ville vue du fleuve. Le capitaine de la felouque donna l’ordre à son équipage de hisser la grande voile qui filtrait les rayons du soleil de la chaleur étouffante. Cette voile blanche donnait un aspect majestueux à la felouque. Je me sentais seul au monde, libre.
A bord de la felouque, des odeurs d'huile et d'épices contenues dans de grandes jarres se mêlaient toutes les unes aux autres et le vent les brassait.
A bord de la felouque, des odeurs d'huile et d'épices contenues dans de grandes jarres se mêlaient toutes les unes aux autres et le vent les brassait.
Au fil de l'eau, mon regard se portait sur les paysages et les rives du Nil, ce fleuve navigué par de petits et grands bateaux. Je croisai des petits bateaux qui servent aux paysans pour les transports de fruits et de légumes de couleurs multiples. Que de couleurs, que d'odeurs ! La descente sur le Nil réveillait tous mes sens.
Au détour d'un méandre, mon regard s'attarda sur de grands radeaux qui étaient utilisés pour la construction des pyramides des grands pharaons comme Ramsès 2. Ces radeaux avaient l'air immenses. Les pyramides se voulaient plus splendides les unes que les autres. Ces constructions humaines atteignaient la somptuosité des rois qu'elles représentaient. Ramsès le Grand avait déjà fait sculpter différentes statues à son effigie. Il s'agissait d’une entreprise titanesque. On pouvait voir les hommes aller et venir, tirant de longues cordes à mains nues pour décharger les radeaux.
Au détour d'un méandre, mon regard s'attarda sur de grands radeaux qui étaient utilisés pour la construction des pyramides des grands pharaons comme Ramsès 2. Ces radeaux avaient l'air immenses. Les pyramides se voulaient plus splendides les unes que les autres. Ces constructions humaines atteignaient la somptuosité des rois qu'elles représentaient. Ramsès le Grand avait déjà fait sculpter différentes statues à son effigie. Il s'agissait d’une entreprise titanesque. On pouvait voir les hommes aller et venir, tirant de longues cordes à mains nues pour décharger les radeaux.
D'étranges morceaux de bois semblaient flotter sur le f1euve. Le capitaine de la felouque m'expliqua avec son regard averti que ce n'étaient pas des morceaux de bois, mais des crocodiles qui étaient attirés par les animaux qui venaient boire sur les rives du fleuve.
Au fil de la descente du fleuve, les paysages étaient différents.
Ici et là, de grandes oasis aux couleurs multiples se déployaient sous nos yeux, des cultures d'oliviers, de dattes et de fleurs qui servent à faire des parfums, de grands palmiers qui servent d'ombrelles aux gens qui regardent passer les navires de voyageurs, ou des denrées alimentaires qui approvisionnent les grandes villes d'Égypte.
Mes yeux furent émerveillés. Je croyais connaître l'Égypte, mais je me rendais compte que je n'en connaissais qu'une infime partie. Toutes ces choses que l'on oublie de voir alors qu’elles nous entourent et embellissent notre vie !
Au fil de la descente du fleuve, les paysages étaient différents.
Ici et là, de grandes oasis aux couleurs multiples se déployaient sous nos yeux, des cultures d'oliviers, de dattes et de fleurs qui servent à faire des parfums, de grands palmiers qui servent d'ombrelles aux gens qui regardent passer les navires de voyageurs, ou des denrées alimentaires qui approvisionnent les grandes villes d'Égypte.
Mes yeux furent émerveillés. Je croyais connaître l'Égypte, mais je me rendais compte que je n'en connaissais qu'une infime partie. Toutes ces choses que l'on oublie de voir alors qu’elles nous entourent et embellissent notre vie !
Après trois jours de voyage, le capitaine décida de s'arrêter pour faire le plein de denrées alimentaires. Nous en avons profité pour effectuer un peu de tourisme et pour nous imprégner de l'ambiance qui régnait afin de reprendre contact avec la réalité de la terre ferme.
Quel magnifique pays ! Que de découvertes ! Je repartis avec le capitaine en me promettant de ne pas arrêter mes découvertes ici.
Quel magnifique pays ! Que de découvertes ! Je repartis avec le capitaine en me promettant de ne pas arrêter mes découvertes ici.
Sujet 2
Laura MORILLO (Shalley)
Collège Les Amognes – Saint-Bénin-d’Azy
Laura MORILLO (Shalley)
Collège Les Amognes – Saint-Bénin-d’Azy
Plume d'or
Il était une fois, comme tous les matins, où je me baladais, survolant la plus belle des villes antiques : Rome. Et je m'envolais, emporté par le vent, survolant les thermes, le toit des maisons... Le soleil était là et illuminait mon plumage doré. Des fois, je vois des gens qui me regardent. Impressionnés par mon plumage, je suis poursuivi de regards. Je vois aussi quelquefois mon image, comme une image fixée au mur, entourée d'écriture latine... Elle représente un oiseau me ressemblant fort bien, flottant dans le vent... Est-ce moi ? Est-ce l'image qui apparaît dans ces regards quand ils me fixent ? Seulement, tout cela, je n'y prête pas vraiment attention. A vrai dire, je ne comprends point réellement ces êtres.
Un jour, je décidai de me reposer quelque temps, lors de ma grande balade. Je m'installai alors sur le rebord d'une fenêtre, puis j'observai cet environnement qui m’était inconnu. Malheureusement, à ma grande surprise, je fus percuté par les volets de ce grand bâtiment. Je me relevai avec difficulté, avant de voir une jeune femme étendre ses draps sur un grand fil... sûrement pour les faire sécher ? Celle-ci fût émerveillée par mon image. Au lieu de m'enfuir comme l'aurait fait un autre vulgaire oiseau ordinaire, je me contentai de prendre une position gracieuse. La brave dame me prit dans ses bras doux, j'entendis sa voix retentir, douce et innocente : « Pauvre oiseau que voilà, au plumage doré comme l'or lui-même. Si tu restes là, tes jours seront comptés. Viens dans ma demeure où tu seras nourri, logé, et caché des mauvais marchands qui t'ôteront tout ce qui te couvre ainsi.» Je n'ai malheureusement point compris ces paroles, moi pauvre oiseau que voilà, mais je vis les portes du grand bâtiment s'ouvrir, laissant apparaître l'intérieur de sa somptueuse demeure. J'y pénétrai sans trop de crainte... Le carrelage était froid, le toit était transparent, tout était spacieux. Je partis à la découverte de ce nouveau lieu dans lequel je me trouvais. Je vis un grand lac d’où de la vapeur sortait, chaude, voir même brûlante. Les bains peut-être ? Toutes les salles étaient aussi intéressantes les unes que les autres. Tout m'était inconnu. La brave dame à la voix scintillante, m'appela d'un air mielleux : « Petit ange d'or, viens te désaltérer de mon breuvage et te nourrir de mes mets. Après tout ce chemin, rien de tel qu'un grand festin.» J'entendis, mais je n'ai point compris ces dires. Et quelle importance ? Ma visite est terminée, il est temps que je reprenne mon envol.
Un jour, je décidai de me reposer quelque temps, lors de ma grande balade. Je m'installai alors sur le rebord d'une fenêtre, puis j'observai cet environnement qui m’était inconnu. Malheureusement, à ma grande surprise, je fus percuté par les volets de ce grand bâtiment. Je me relevai avec difficulté, avant de voir une jeune femme étendre ses draps sur un grand fil... sûrement pour les faire sécher ? Celle-ci fût émerveillée par mon image. Au lieu de m'enfuir comme l'aurait fait un autre vulgaire oiseau ordinaire, je me contentai de prendre une position gracieuse. La brave dame me prit dans ses bras doux, j'entendis sa voix retentir, douce et innocente : « Pauvre oiseau que voilà, au plumage doré comme l'or lui-même. Si tu restes là, tes jours seront comptés. Viens dans ma demeure où tu seras nourri, logé, et caché des mauvais marchands qui t'ôteront tout ce qui te couvre ainsi.» Je n'ai malheureusement point compris ces paroles, moi pauvre oiseau que voilà, mais je vis les portes du grand bâtiment s'ouvrir, laissant apparaître l'intérieur de sa somptueuse demeure. J'y pénétrai sans trop de crainte... Le carrelage était froid, le toit était transparent, tout était spacieux. Je partis à la découverte de ce nouveau lieu dans lequel je me trouvais. Je vis un grand lac d’où de la vapeur sortait, chaude, voir même brûlante. Les bains peut-être ? Toutes les salles étaient aussi intéressantes les unes que les autres. Tout m'était inconnu. La brave dame à la voix scintillante, m'appela d'un air mielleux : « Petit ange d'or, viens te désaltérer de mon breuvage et te nourrir de mes mets. Après tout ce chemin, rien de tel qu'un grand festin.» J'entendis, mais je n'ai point compris ces dires. Et quelle importance ? Ma visite est terminée, il est temps que je reprenne mon envol.
Je m'envolai alors à tire d'ailes, continuant ma promenade à travers la grande ville de Rome. Lors de mon petit voyage, pourtant habituel, mon regard croisa celui d'une arène de jeu, où le public s’installait paisiblement. Je m'installai, de mon côté, vers l'enceinte extérieure de l'arène. L'empereur, gracieux, admirait la scène. Il y avait des animaux de toute sorte, sauvages et féroces, des gladiateurs, des courses de chars... Je regardais cela avec la plus grande des curiosités sans trop tout comprendre. « Quelles drôles de coutumes ! » me disais-je. Tout à coup, le vent, mon ami malveillant, me fit un mauvais tour. Celui-ci souffla de son vent de mort, et me fit basculer à l'intérieur de l'arène. Je tombai de façon maladroite au milieu des gladiateurs qui menaient un combat acharné. Je fus ainsi, malgré moi, la source de toutes les attentions. Je ne sais pas, à ce moment là, ce qui me retenait de partir : je restai naïvement à ma place. Le doux soleil se coucha et nous priva de sa lumière. Les paroles tourbillonnaient comme des feuilles mortes et l’empereur me regarda de son air le plus étonné. Ces humains m'enfermèrent dans une cage très sombre, m'offrant l'impossibilité d'en sortir malgré mes efforts. Pourtant, une voix scintillante retentissait, brusquant tout ce brouhaha qui régnait en ce lieu. « Arrêtez ! Cet oiseau n'est point celui que vous cherchez ! ». Je reconnus cette voix, il s'agissait des paroles ailées de la jeune femme qui m'a recueilli chez elle. L'empereur prit la parole d'une voix grave et imposante : « Qui est-tu paysanne ? Comment oses-tu me contredire ? Ceci est l'oiseau au plumage d'or qui s'illumine tous les matins dans le ciel bleu. Je me servirais de son plumage pour me vêtir, et de sa chair pour me nourrir. ». Il dit, et la brave dame répondit : « 0 grand empereur ! Voyons, regardez de vos yeux azurs ! Son pelage n'est point doré. Celui-ci est aussi marron que le bois qui fait notre feu.» L'ombre me recouvrait, et hélas il est vrai, que mon pelage une fois assombri, est aussi marron que le fruit lui-même. Tout le monde fut stupéfait. Ils me relâchèrent, puis je m'envolai en toute hâte. Je me rappelle avoir laissé une plume derrière moi, que la brave dame a ramassée... « Oh doux ciel, que lui est-il arrivé ? » me disais-je inquiet.
Maintenant je survole toujours la ville de Rome tous les matins. Je vois toujours le toit des maisons, toujours des gens qui me regardent, toujours le doux soleil qui m'illumine. Et souvent, je vois une plume s'illuminer entre les maisons, et une brave dame la tenir. Elle m’adresse toujours un sourire, et d'en mon cœur d'oiseau, qui, lui, est bien ordinaire, je lui souris aussi...
Niveau 5e
Sujet 1
Aubin GADY (Cook)
Collège du Vallon - Autun
Aubin GADY (Cook)
Collège du Vallon - Autun
Journal de bord de la Santa-Magdalena
Aujourd'hui le jeudi 28 février de l'an de grâce 1496. Je me nomme Juan y Cordoba et je suis capitaine depuis 5 ans déjà. Quand le grand capitaine Christophe Colomb est revenu des Indes, notre cher roi d'Espagne s'est grandement intéressé à ce type de découvertes. Comme j'avais navigué auparavant, il me confia la mission de m'embarquer pour les Indes et de lui rapporter tout ce que j'y trouverais d'hommes, de nourriture et de tissus.
Je dois donc prendre la mer le dimanche premier mars, premier jour de l'année. La caravelle que nous avons armée s'appelle la Santa-Magdalena. C'est un robuste bâtiment de 180 tonneaux. L'équipage est constitué d'une quinzaine de marins et de mousses, d'un charpentier, d'un voilier, d'un tonnelier, du pilote, du second et de moi-même. Nous allons partir du port de Lisboa.
Puisse Dieu nous protéger et nous sauvegarder !
Je dois donc prendre la mer le dimanche premier mars, premier jour de l'année. La caravelle que nous avons armée s'appelle la Santa-Magdalena. C'est un robuste bâtiment de 180 tonneaux. L'équipage est constitué d'une quinzaine de marins et de mousses, d'un charpentier, d'un voilier, d'un tonnelier, du pilote, du second et de moi-même. Nous allons partir du port de Lisboa.
Puisse Dieu nous protéger et nous sauvegarder !
Dimanche 1er mars
Quand le bateau est sorti du port ce matin, une foule immense était sur le quai. Même sa Majesté le roi était présent, en compagnie de la reine. Les amarres furent larguées sans problème et le bateau entama sa longue traversée vers les Indes. Le vent était bon et la caravelle avançait rapidement.
Dimanche 8 mars
La première nuit fut bonne, et les jours suivants, la Santa-Magdalena continua à vive allure. Les hommes étaient joyeux et travaillaient hardiment. Mais depuis ce matin, le vent est un peu moins clément. Nous devons donc hisser le perroquet, qui jusqu'à là n'avait pas servi.
Mardi 17 mars
Cette nuit, le vent s'est brusquement levé et de hautes vagues se fracassaient sur la coque du navire. Au petit matin, une des voiles s'est décrochée et s'est abattue sur le pont de la caravelle. Les marins l'ont raccrochée sans trop de mal : c'est le premier incident du voyage.
Jeudi 2 avril
La navigation s'est poursuivie sans problème jusqu'à ce qu'un galion de pirates nous attaque. C'était en plein midi et les hommes étaient en train de se reposer à l’ombre du grand mât. Soudain la vigie a crié qu'un bateau avançait à vive allure. Quand je regardai par la longue-vue, j'aperçus le pavillon noir si redouté. J'ordonnai alors à l'homme de quart de virer de bord. Mais le galion était trop rapide et il tira un premier coup de canon. Au troisième coup, le safran se fit toucher. Les pirates en profitèrent pour accoster notre caravelle. Mes hommes descendirent alors dans la cale et s'armèrent les uns de mousquets, les autres de fusils et de fleurets. Ils remontèrent sur le pont et se lancèrent à l’assaut des pirates qui furent surpris de la rapidité et de la vivacité de la réaction. Bientôt, ils furent mis en déroute par mes hommes. Les pirates survivants s'empressèrent de sauter hors de notre caravelle. Nous avons quatre hommes blessés et un mort. Ses compagnons lui ont fait une belle cérémonie.
Vendredi 10 avril
La grande voile s'est trouée lors d'une tempête. Le maître voilier l'a remplacée par une voile que nous conservions dans la cale. Le safran du gouvernail qui avait été abimé pendant l'attaque des pirates a été réparé ; nous avons dû construire un radeau pour le remplacer ...
Lundi 27 avril
Le vent s'est arrêté de souffler et le bateau a considérablement réduit sa vitesse. Les hommes s'occupent de nettoyer les armes et les cuirasses, de laver le pont, de calfeutrer la coque...
De mon côté, je trace la route que nous suivons, je lis les traités de navigateurs ou je me repose. Ma cabine est rectangulaire. Elle est composée de mon lit, de mon bureau et d'une bibliothèque. Elle est éclairée par une petite fenêtre. Ma chambre est adjacente à celle du second.
De mon côté, je trace la route que nous suivons, je lis les traités de navigateurs ou je me repose. Ma cabine est rectangulaire. Elle est composée de mon lit, de mon bureau et d'une bibliothèque. Elle est éclairée par une petite fenêtre. Ma chambre est adjacente à celle du second.
Jeudi 6 mai
Nous profitons d'un fort courant qui nous entraîne vers notre destination. Les hommes ont pris du rhum dans la cale. Nous avons vu des poissons volants. Le soleil est ardent et les hommes ont chaud. Ils se relaient pour tendre les poulies, rabattre les voiles ou nouer les câbles.
Mercredi 19 mai
Nous naviguons dans une mer encombrée d'algues vertes : l'horizon est d'un vert soutenu. Deux hommes ont essayé d'en pêcher. Elles ressemblent aux algues que l'on trouve sur les côtes espagnoles. Cependant, elles n'empêchent aucunement le passage de la caravelle. Le second en a déduit que nous approchions des côtes.
Les hommes s'impatientent quelque peu ; je les comprends car le voyage a été long et ils sont impatients d'arriver.
Les hommes s'impatientent quelque peu ; je les comprends car le voyage a été long et ils sont impatients d'arriver.
Mardi 25 mai
La vigie et plusieurs des hommes ont aperçu des oiseaux volant dans les parages. Nous approchons sans doute des côtes indiennes. L'équipage est plus que jamais aux aguets : il se place sur le château avant et surveille jour et nuit l'horizon.
Pour le moment, je ne peux rien distinguer, même avec ma longue-vue. Je trouve les eaux plus bleues que quand nous sommes partis de Lisboa. Une brise chaude caresse sans arrêt la voilure.
Pour le moment, je ne peux rien distinguer, même avec ma longue-vue. Je trouve les eaux plus bleues que quand nous sommes partis de Lisboa. Une brise chaude caresse sans arrêt la voilure.
Jeudi 27 ma
iC'est aujourd'hui, plus précisément à 4 heures de l'après-midi que la vigie a crié
« Terre !!, terre droit devant ! »
Les hommes se sont rués à la proue, se bousculant pour apercevoir ce continent bien peu connu. Je suis monté sur le château arrière pour tenter de distinguer à l’horizon ces terres. Il y avait des arbres à perte de vue.
Quand la caravelle était à une trentaine de brasses de la côte, nous avons aperçu des arbres inconnus, des plantes aux fleurs éclatantes de couleurs et des oiseaux au plumage merveilleux. Nous avons ancré la Santa-Magdalena dans une petite crique protégée du vent.
« Terre !!, terre droit devant ! »
Les hommes se sont rués à la proue, se bousculant pour apercevoir ce continent bien peu connu. Je suis monté sur le château arrière pour tenter de distinguer à l’horizon ces terres. Il y avait des arbres à perte de vue.
Quand la caravelle était à une trentaine de brasses de la côte, nous avons aperçu des arbres inconnus, des plantes aux fleurs éclatantes de couleurs et des oiseaux au plumage merveilleux. Nous avons ancré la Santa-Magdalena dans une petite crique protégée du vent.
Lundi 31 mai
Nous sommes descendus à terre. J'y ai planté le drapeau espagnol et le second y a planté un drapeau représentant le Christ. Nous commençons à décharger les vivres, les armes et la poudre. Je suis en train de prendre la latitude et la longitude de l'endroit où le bateau se trouve amarré. Nous voyons tous les jours des animaux inconnus et des plantes surprenantes.
Vendredi 4 juin
Nous avons pénétré dans la forêt, qui, par endroit, est particulièrement dense et touffue. Nous avons cueilli des feuilles pour les faire sécher dans un herbier et les montrer au roi. Nous avons construit des cages pour y mettre des oiseaux et des mammifères. J'ai dessiné la flore typique de ce continent.
Mardi 8 juin
Nous avons continué notre exploration dans la forêt. Nous avons aujourd'hui traversé un espace marécageux encombré de saules et de joncs. Nous avons dû protéger la poudre de l'eau sale du marais. Nous sommes arrivés au bas d'une colline escarpée et nous l'avons grimpée, non sans mal. D'en haut, nous avons découvert une petite vallée, et une colonne de fumée s'échappait d'une clairière. Nous en avons déduit la présence d'hommes.
Mercredi 9 juin
Nous avons pris la direction de la colonne de fumée. Nous y avons vu des hommes au teint brun et vêtus seulement d'un pagne. Quand ils nous ont aperçus, ils ont pris peur, puis quelques-uns d'entre eux se sont avancés vers nous. Je leur ai alors montré un coffre contenant des objets de pacotille. Ils se sont approchés et ont touché la pacotille. Celui qui semblait être leur chef a pris le couteau qui pendait à sa ceinture et me l'a tendu. J'ai fait de même avec la pacotille. Tous ces échanges se sont faits dans le plus grand silence. L'homme m'a alors guidé vers un village composé de petites huttes recouvertes de paille. Je lui ai fait comprendre par signes que je l'emmènerais volontiers, avec quelques hommes, dans mon pays, où je le présenterais au roi d'Espagne. Il m'a dit qu'il y réfléchirait...
Mardi 15 juin
Le chef indigène a accepté de s'embarquer avec moi. Il m'a montré des armes et il m'a appris à conserver la viande et le poisson dans une technique nouvelle. Il m'a démontré les effets d'un poison très violent qu'il utilisait pour la chasse et qui paralyse ceux qui sont touchés par ce liquide.
Jeudi 17 juinNous sommes revenus au bateau avec les animaux, les plantes, les dessins et les indigènes. Nous avons refait des provisions et nous avons pris de l'eau douce pour le retour. Nous avons vérifié toute la coque et l'équipage a revu toute la voilure. Nous allons prendre le large le samedi 19 juin 1496.
Samedi 19 juin
C'est aujourd'hui que la caravelle part. Espérons qu'elle fera bonne route...
Sujet 2
Joachim TOURNEBIZE (JT00712102000)
Collège Pierre-Paul Prudhon – Cluny
Collège Pierre-Paul Prudhon – Cluny
La huitième croisade
Nous sommes en décembre 1271. Je m'appelle Joachim de Lys, et vis près du village aux trois sources, dans le sud de la Bourgogne. J'ai décidé de me joindre en juin 1270 à la huitième croisade avec notre bon Roi Saint-Louis, laissant au château mon épouse Élise, ainsi que mes trois fils : Arthur, Pierre et Jean. J'ai combattu aux côtés de grands seigneurs, tuant moult innocents et pillant toutes les villes traversées. Mais seuls les favoris du Roi étaient récompensés. J'ai grande honte d'avoir causé tant de malheurs au nom de Dieu, qui est pourtant symbole d'amour et de paix. C'est alors que je rencontrai un pèlerin récemment arrivé en Terre Sainte. Il me conta l'attaque de mon domaine. Inquiet, épuisé, je décidai de revenir dans ma seigneurie au plus vite.
Mais, le voyage fut vite ralenti par des incidents plus ou moins graves. Sur la vingtaine de personnes qui m'accompagnaient, seulement une dizaine avait survécu à notre épopée en Orient. Un soir l’on dormait dans une grotte, je sortis prendre l'air, quand soudain j'entendis un rugissement suivi d'une grande lumière éblouissante. Je voyais d'où provenait ce bruit terrifiant mais ne savais pas ce qui le provoquait. Mes yeux fouillaient l'obscurité, jusqu'à percevoir une grosse masse ailée atterrir sur le sol. Était-il possible que la vision terrifiante fût réelle !? En effet plus un doute ne subsista quand je me retrouvai nez à nez avec la bête : c'était un dragon, rouge flamboyant, avec des yeux aussi sombres que les ténèbres. Soudain, il ouvrit sa gueule prête à cracher du feu. Je pris mon écu dans mon dos pour me protéger. Le métal fut rapidement si brûlant que je dus le lâcher. Je sentais mon heure venir, quand je vis des cordes s'enrouler autour des pattes et de la gueule du monstre : c'étaient mes compagnons de voyage réveillés par le bruit. Le dragon perdit l'équilibre, je pris mon épée à deux mains et je lui transperçai le cœur. Une fois que nous fûmes certains que la bête était morte, nous décidâmes de rentrer nous remettre de nos émotions, et chercher nos affaires dans la grotte. Mais quelqu'un vit une petite lumière étincelante. En m'approchant plus près, j'aperçus une montagne d'or et de pierres précieuses : le trésor du dragon ! Nos cris de joie attirèrent nos compagnons. Finalement, notre croisade était récompensée, et nous n'avions pas assez de quatre mules pour tout emporter. Ainsi nous pûmes continuer notre chemin le cœur en fête.
Quelques jours passèrent, quand une petite bande de brigands surgit des buissons. Ils étaient huit, armés de glaives. Ils voulurent nous voler notre trésor, mais nous étions mieux armés qu'eux et surtout, notre expérience de croisés nous avait fortifiés dans nos combats. Nous nous en sortîmes avec quelques légères blessures ; dans leur fuite ils réussirent à prendre un petit sac d'or, mais ce qui nous restait représentait une fortune encore assez large à partager. Le reste du voyage nous fîmes plus attention, ne faisant pas de feu au campement et envoyant des éclaireurs dans les endroits délicats.
Enfin nous arrivâmes en vue du château de Lys. Nous étions chez nous ! Cette joie fut de courte durée, quand nous vîmes la herse gisant au sol et une large brèche qui avait ouvert les remparts. Les toits des chaumières de paysans avaient brûlé, et à part quelques poules il n'y avait personne dans le village. Nous étions atterrés, où étaient nos familles ? Après avoir mis pied à terre, avançant avec précaution, nous découvrîmes un spectacle qui nous glaça le sang : le village avait été pillé, les hourds flottaient dans les douves. Arrivant au donjon, je découvris un message accroché à la porte défoncée.
« Seigneur de Lys, si tu souhaites revoir ta famille et tes gens il t'en coûtera mille pièces d'or » et c'était signé Hugues de Brancion.
Le fourbe n'avait pas répondu à l'appel des croisades de Saint-Louis. Seules les femmes, le vin et les jeux l'intéressaient. Sa conduite pas très chrétienne n'était pas en rapport avec celle d'un croisé. Il en avait donc profité pour piller les comtés laissés sans défense, et s'approprier les biens et les femmes des courageux guerriers. Nous avons prélevé sur le butin du dragon les mille pièces d'or et caché le reste en faisant jurer silence à tous. Sans plus attendre nous partîmes vers la montagne de Brancion, ce satané Hugues aurait pu nous voir, mais notre plan était d'arriver par surprise. Nous nous glissâmes à travers la forêt, pour nous retrouver à l'église. Tout alla si vite que nous en rîmes ensuite : Hugues et ses hommes de beuverie ne savaient pas que nous étions de retour. Une fois regroupés, nous descendîmes le village pour rejoindre le château. Lorsque nous fûmes arrivés à la taverne, leurs cris de couards ivres nous firent comprendre qu'ils étaient tous à table. Ce fut bientôt des cris de gorets qu'ils poussèrent sous le coup de nos épées, et notre fureur d'avoir été trompés par un seigneur voisin décupla nos forces et notre ruse. Bien vite nous pûmes ainsi libérer nos familles enfermées dans les souterrains, affamées mais saines et sauves. Finalement nous n'avions pas eu à donner l’or.
« Seigneur de Lys, si tu souhaites revoir ta famille et tes gens il t'en coûtera mille pièces d'or » et c'était signé Hugues de Brancion.
Le fourbe n'avait pas répondu à l'appel des croisades de Saint-Louis. Seules les femmes, le vin et les jeux l'intéressaient. Sa conduite pas très chrétienne n'était pas en rapport avec celle d'un croisé. Il en avait donc profité pour piller les comtés laissés sans défense, et s'approprier les biens et les femmes des courageux guerriers. Nous avons prélevé sur le butin du dragon les mille pièces d'or et caché le reste en faisant jurer silence à tous. Sans plus attendre nous partîmes vers la montagne de Brancion, ce satané Hugues aurait pu nous voir, mais notre plan était d'arriver par surprise. Nous nous glissâmes à travers la forêt, pour nous retrouver à l'église. Tout alla si vite que nous en rîmes ensuite : Hugues et ses hommes de beuverie ne savaient pas que nous étions de retour. Une fois regroupés, nous descendîmes le village pour rejoindre le château. Lorsque nous fûmes arrivés à la taverne, leurs cris de couards ivres nous firent comprendre qu'ils étaient tous à table. Ce fut bientôt des cris de gorets qu'ils poussèrent sous le coup de nos épées, et notre fureur d'avoir été trompés par un seigneur voisin décupla nos forces et notre ruse. Bien vite nous pûmes ainsi libérer nos familles enfermées dans les souterrains, affamées mais saines et sauves. Finalement nous n'avions pas eu à donner l’or.
Le retour au château, malgré l’épuisement dû au manque de nourriture, se fit dans la joie générale. Etre libres et nous retrouver ragaillardissait tout le monde. Grâce au trésor et à l’entraide de tous, le château et le village retrouvèrent leur belle allure. Même en mieux, car toutes les découvertes dues aux pays traversés permirent beaucoup d'améliorations et de confort. Au printemps, je pus admirer le nouveau visage de ma seigneurie au bras de ma douce épouse dont le ventre s'arrondissait. Un heureux évènement s'annonçait, mais ce n'était pas le seul ; pour célébrer tout ce renouveau mon fils Arthur se maria avec une damoiselle nommée Marie. Pour l’occasion cinq jours de fête furent donnés. Enfin nous étions revenus chez nous, mais quelques-uns manquaient dans nos cœurs. La nuit, des rêves agités par la violence de combats menés en Terre Sainte me tourmentaient régulièrement. Mais, à la joie de mon village retrouvé, je savais que le temps apaiserait mes tourments.
Niveau 4e
Sujet 1
1er prix : Morgane LEGROS (Directioner)
Collège Jean Vilar – Chalon-sur-Saône
1er prix : Morgane LEGROS (Directioner)
Collège Jean Vilar – Chalon-sur-Saône
Au secours de Sa Majesté !
Il était cinq heures du matin. Je devais aller me lever pour aller travailler comme assistante apothicaire. Il y avait huit kilomètres de marche mais je gagnais un salaire qui permettait de subvenir aux besoins de ma famille. Je pris ma besace et mis mes sabots. Le jour commençait à se lever. Je traversais mon village et j'arrivais devant une petite mare où se trouvaient des canards qui flottaient. Je regrettais de ne pas avoir assez de pain pour pouvoir leur en donner. On se trouvait dans une période de famine et le roi Louis XVI ne trouvait aucune solution pour remédier à ce problème. Le pays ployait sous les dettes. J'arrivai, enfin, devant la bâtisse de mon employeur. Aujourd'hui, je devais piler des feuilles de marronnier afin de confectionner un remède contre les maux de tête. Cela me prit toute ma matinée.
L'après-midi, je mélangeai mes feuilles écrasées avec de l'eau. On aurait presque dit une soupe. Ce jour-là, j'avais demandé à pouvoir rentrer plus tôt chez moi car mes parents devaient m'annoncer une grande nouvelle. Sur le chemin, je décidais de cueillir des fleurs pour les offrir à ma maman.
L'après-midi, je mélangeai mes feuilles écrasées avec de l'eau. On aurait presque dit une soupe. Ce jour-là, j'avais demandé à pouvoir rentrer plus tôt chez moi car mes parents devaient m'annoncer une grande nouvelle. Sur le chemin, je décidais de cueillir des fleurs pour les offrir à ma maman.
Arrivée devant chez moi, j'aperçus une calèche. Je décidai donc de rentrer par derrière. La porte entrouverte me permettait d'entendre des bribes de conversation :
« -Messieurs, dit-ma mère, ne prenez pas notre maison, c'est tout ce qu'il nous reste !
- Comme nous a expliqué votre mari, il a dépensé toutes vos économies aux jeux. Vous êtes donc dans l'incapacité à payer votre loyer. Nous devons saisir votre maison et vos biens et si vous refusez, on doit aussi vous emmener auprès du juge.
-Mais..., murmura mon père avant de se faire couper.
- Pas de discussions ou l’on vous garde avec nous. »
« -Messieurs, dit-ma mère, ne prenez pas notre maison, c'est tout ce qu'il nous reste !
- Comme nous a expliqué votre mari, il a dépensé toutes vos économies aux jeux. Vous êtes donc dans l'incapacité à payer votre loyer. Nous devons saisir votre maison et vos biens et si vous refusez, on doit aussi vous emmener auprès du juge.
-Mais..., murmura mon père avant de se faire couper.
- Pas de discussions ou l’on vous garde avec nous. »
Je compris tout de suite que les deux hommes présents dans notre logement étaient des huissiers. J'en voulais à mon père mais en même temps j'avais peur pour notre avenir. Je ressentais aussi une profonde tristesse car on allait peut-être emprisonner mes parents.
Je décidai qu'il fallait que je me cache. Il y avait, au fond de la cour, un large puits avec un grand chêne juste devant. Je me réfugiai derrière et vis les deux huissiers tirer mes parents vers leur véhicule. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues ; je les chassai du revers de ma manche. Une fois que je ne les aperçus plus, je courus en direction de ma maison. Je fus soulagée lorsque je découvris qu'ils n'avaient rien saccagé. Soudain, des pas se firent entendre. Devant moi, je vis la vieille malle que ma grand-mère nous avait léguée. Elle était vide. J'en profitai pour me plisser à l'intérieur.
Les deux individus rentrèrent dans ma petite demeure. Je les entendis fouiller. Tout d’un coup ils parlèrent :
« - Ce coffre a l’air très solide et il est joliment sculpté. Je pense que nous devrions le rapporter à la cour. Cela ferait un très beau cadeau pour le roi. »
« - Ce coffre a l’air très solide et il est joliment sculpté. Je pense que nous devrions le rapporter à la cour. Cela ferait un très beau cadeau pour le roi. »
Ils travaillaient donc pour le roi. Mon père avait dû avoir de graves ennuis. Mes parents voulaient probablement me parler de ça.
Je sentis la malle bouger, il me semblait qu'ils la portaient puis je sentis m'on me lâchait. Heureusement que cette malle était très large et très haute. Au bout d'un moment, la calèche s'arrêta et je fus projetée en avant. Ma tête me tourna et j'eus comme l'impression d'avoir des vertiges puis je ne me rappelais plus de rien. Selon moi, j'avais fait un malaise.
Lorsque je me réveillais, il me semblait qu'on était arrêté. J'entendis les deux compères parler de nouveau :
« - Nous sommes enfin arrivés à Versailles. On doit aller livrer notre rapport au roi et lui offrir notre cadeau.
- Oui et nous devons faire emprisonner le couple que nous transportons.
- Commençons d’abord par nous occuper des prisonniers. »
« - Nous sommes enfin arrivés à Versailles. On doit aller livrer notre rapport au roi et lui offrir notre cadeau.
- Oui et nous devons faire emprisonner le couple que nous transportons.
- Commençons d’abord par nous occuper des prisonniers. »
Nous étions à Versailles à la cour du roi. J'en étais toute retournée mais il fallait que je sorte vite de la malle sans me faire attraper. J'allais arriver dans un endroit que je ne connaissais pas ; il faudrait que je me débrouille pour libérer mes parents et me trouver un travail. Le château était grand. Je pense que je n'aurais pas de mal à me trouver un emploi. Je n'entendis aucun bruit et décidai de soulever le couvercle de la malle très lentement. Je me trouvais dans une somptueuse écurie. Par chance, il n'y avait personne. Je m'approchai discrètement de la calèche mais il n'y avait plus personne à l'intérieur. Ils avaient déjà dû emmener mes parents. Lorsque je voulus sortir, un jeune garçon m'interpella :
« Hé toi, que fais-tu dans les écuries royales ?
- Je...
- Tu es nouvelle, je crois ne jamais t'avoir rencontré auparavant et pourtant, je rencontre du monde.
- Oui...
- Tu ne m'as pas l'air bavarde. Bon, je vais te faire visiter les écuries ?
- Non, il faut que je parte. >>
- Je...
- Tu es nouvelle, je crois ne jamais t'avoir rencontré auparavant et pourtant, je rencontre du monde.
- Oui...
- Tu ne m'as pas l'air bavarde. Bon, je vais te faire visiter les écuries ?
- Non, il faut que je parte. >>
Je me mis à courir et arrivai sur une immense place. J'avais sans m'en rendre compte franchi une grande porte en or. Le garçon m'avait suivi et il arriva essoufflé devant moi en me disant :
« il ne faut pas que tu t'échappes à chaque fois que quelqu'un essaye de te parler. Versailles est un endroit qui peut se révéler dangereux si on ne le connaît pas.
- Pourquoi veux-tu m’aider ?
- Tu m’as l’air vraiment perdue et j'ai l'impression que tu cherches à te cacher à tout prix. Je me trompe ?
• Je ne sais pas mais il faudrait que je me trouve du travail. >>
« il ne faut pas que tu t'échappes à chaque fois que quelqu'un essaye de te parler. Versailles est un endroit qui peut se révéler dangereux si on ne le connaît pas.
- Pourquoi veux-tu m’aider ?
- Tu m’as l’air vraiment perdue et j'ai l'impression que tu cherches à te cacher à tout prix. Je me trompe ?
• Je ne sais pas mais il faudrait que je me trouve du travail. >>
Il me proposa donc de m'emmener près de sa sœur qui avait un bon poste auprès de la reine ; elle était sa camériste. Tout au long du trajet, il me raconta beaucoup de choses sur lui. Il m'expliqua aussi en quoi consistait ce travail : il fallait s'occuper de sa majesté en toutes circonstances, l'habiller, le coiffer, la maquiller et veiller sur elle.
Cette fille qui était sa sœur, lui ressemblait beaucoup. On aurait presque pu dire qu'ils étaient jumeaux. Elle me proposa d'être son assistante-camériste car l'ancienne avait démissionné. Il fallait d'abord qu'elle en parle avec son intendant. Son frère nous laissa et on alla donc rejoindre ce monsieur.
Il paraissait vraiment gentil. Il me semblait grand et bien bâti. Il portait une perruque brune qui, je supposais, le rajeunissait et une redingote très luxueuse qui montrait l'étendue de ses pouvoirs. La fille qui m'accompagnait prit donc la parole :
- « Monsieur l'intendant, je voudrais vous quémander une faveur. Suite à la démission de mon ancienne assistante, vous m'aviez fait part de votre désir de retrouver une nouvelle employée. Ma jeune cousine que vous voyez là, vient d'arriver à Versailles et j'aimerais savoir si vous pouviez l'embaucher?
- Etant donné la qualité de votre travail je vous l'accorde mais à la moindre erreur de cette demoiselle, je la renvoie et vous aussi par la même occasion. >>
- « Monsieur l'intendant, je voudrais vous quémander une faveur. Suite à la démission de mon ancienne assistante, vous m'aviez fait part de votre désir de retrouver une nouvelle employée. Ma jeune cousine que vous voyez là, vient d'arriver à Versailles et j'aimerais savoir si vous pouviez l'embaucher?
- Etant donné la qualité de votre travail je vous l'accorde mais à la moindre erreur de cette demoiselle, je la renvoie et vous aussi par la même occasion. >>
Nous le remerciâmes et partîmes en direction des appartements de la reine. Je demandai à ma compagne qui s'appelait Olympe pourquoi elle m'avait fait passer pour sa cousine et elle me répondit que cela donnait une meilleure impression de la personne qui veut trouver un travail à Versailles.
Nous étions dans les appartements de la reine et je m'étonnais qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit. Olympe me répondit que la reine était tombée malade après l'affaire du collier. Elle avait dû subir de nombreux reproches et plus en plus de gens la voyaient comme une ennemie. Elle m'apprit aussi que les médecins n’arrivaient pas à la soigner malgré les saignées quotidiennes qu'on lui faisait.
Quelques minutes après qu'elle m'ait enseigné certaines règles l'étiquette, nous entrâmes dans la chambre de la reine. Je m'inclinai dans une profonde révérence et mon amie me présenta. Je fus obligée de constater que la reine se trouvait dans un état valétudinaire. Elle semblait triste. Elle me rappelait une patiente qui était venue me voir lorsque que j'exerçais encore mon travail d'apothicaire à la campagne. La reine nous autorisa à sortir car les médecins allaient arriver. Pendant ce temps, je demandai à Olympe où est-ce que je pourrais trouver des apothicaires dans Versailles. Elle fut surprise par ma question mais m'y conduisit quand même.
Nous retrouvâmes devant une apothicairerie vide. Je lui demandai me laisser seule car je m'apprêtais à faire quelque chose d'interdit. Elle partit et je m'introduisis dans la pièce. J'étais prête à tout faire pour retrouver mes parents. S'il fallait que je sauve la reine pour qu'elle m'accorde une faveur, je le ferais. Je rassemblais tout ce dont j'avais besoin grâce aux noms inscrit sur les tiroirs et me dépêchais de préparer ce breuvage qui avait déjà sauvé une personne. J'aperçus une fiole, la glissai à l'intérieur de ma poche et partis après avoir vérifié que tout semblait à sa place.
De retour dans les appartements de la reine, je retrouvais Olympe qui m'apprit que cette nuit, je devais m'occuper de la reine. Ce fut mon tour, je rentrai dans la chambre de la reine, m'inclinai devant elle et m'assis dans un fauteuil près de son lit. Elle commença à me parler. Elle voulait que je lui raconte ce que je faisais avant d'être ici. Je lui racontais tout sauf la façon dont j'étais arrivée à Versailles. Elle me dit que je devais savoir beaucoup de choses étant donné que j'avais travaillé avec un apothicaire. Voyant qu'elle commençait à s'endormir, je décidai donc de mettre mon plan à exécution, je lui proposai de boire mon breuvage : elle fut méfiante mais accepta quand même en disant que c'était un des remèdes qu'elle n'avait pas encore essayé. Elle le but puis s'endormit.
Deux semaines passèrent, je m'occupais toujours de la reine et elle allait de mieux en mieux. Mon remède faisait effet petit à petit. Un matin, un garde vint me chercher. Le roi avait demandé à me voir. J'étais à la fois inquiète et heureuse. Que pouvait-il me vouloir ? On m'emmena donc dans le grand appartement du roi. Quand j'entrai, je fus époustouflée par la beauté du lieu. Je m'inclinai devant Je roi qui était entouré par ses plus fidèles courtisans. Ceux-ci s'écartèrent et le roi me demanda d'approcher. Il prit la parole :
« -Est-ce bien toi, jeune fille, qui a administré un remède à madame la Reine ?
- Oui, mais je ne voulais pas la tuer, je voulais juste la soigner, je...
-Mais, je ne t'en veux pas. Elle m'a tout raconté. Tu l'as soignée et elle a retrouvé son sourire et sa bonne humeur. Grâce à ce geste que tu as eu envers elle, je pense que je te dois une faveur. Quel est ton souhait ?
-Monsieur le Roi, si je puis me le permettre, j'aimerais vous demander s'il serait possible de faire délivrer mes parents qui ont été emmenés par des huissiers. Je sais qu'on les a conduits ici.
- J'accepte à une condition. Tu devras rester à Versailles afin de t'occuper de Madame qui t'apprécie beaucoup et me vante tes qualités. »
Je réfléchis quelques minutes et fit part de ma décision au roi. J'acceptais sa proposition. Je lui donnai les noms de mes parents et on me demanda de partir.
« -Est-ce bien toi, jeune fille, qui a administré un remède à madame la Reine ?
- Oui, mais je ne voulais pas la tuer, je voulais juste la soigner, je...
-Mais, je ne t'en veux pas. Elle m'a tout raconté. Tu l'as soignée et elle a retrouvé son sourire et sa bonne humeur. Grâce à ce geste que tu as eu envers elle, je pense que je te dois une faveur. Quel est ton souhait ?
-Monsieur le Roi, si je puis me le permettre, j'aimerais vous demander s'il serait possible de faire délivrer mes parents qui ont été emmenés par des huissiers. Je sais qu'on les a conduits ici.
- J'accepte à une condition. Tu devras rester à Versailles afin de t'occuper de Madame qui t'apprécie beaucoup et me vante tes qualités. »
Je réfléchis quelques minutes et fit part de ma décision au roi. J'acceptais sa proposition. Je lui donnai les noms de mes parents et on me demanda de partir.
Un mois plus tard, j'avais retrouvé mes parents. Ils n'avaient pas été mis en prison, ni condamnés. J'étais la plus heureuse des jeunes filles. Le roi avait tenu sa promesse et je devais donc tenir la mienne. Je travaillais toujours pour la reine. Le roi avait permis à mon père de faire partie de ses jardiniers et à ma mère de travailler en tant que blanchisseuse. Dans quelques mois, les Etats Généraux devaient se réunir. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Enfin je l'espère. Par contre, il ne faut pas que cela rende à nouveau le Reine malade. Je tiens trop à elle. Elle me considère même comme sa fille. Mais cela reste une autre histoire !
2e prix : Félicie REMLINGER et Hélène OSSEDAT
(Marie-Antoinette)
Collège Notre-Dame de Varanges - Givry
(Marie-Antoinette)
Collège Notre-Dame de Varanges - Givry
Jusqu'où peut mener une orange ?
L'histoire se déroule en 1775. Jules est un jeune homme de 18 ans élevé dans un monastère de Paris depuis sa naissance. Lassé de la vie de moine, il décide de fuguer de celui-ci. Il se retrouve donc seul dans les alentours de la capitale.
Au lever du jour, je me réveillai affamé dans une ruelle sombre. Je parcourus alors un marché, et j'avisai un étalage de fruits et légumes. Dans un panier d'osier, reposaient de belles et grosses oranges. Le marchand était occupé avec deux hommes de bonne carrure qui étaient habillés en paysans. Ils débattaient du prix de l’avoine à vive voix et ne feraient donc pas attention à un garçon des rues. J'en profitai et attrapai discrètement une orange, celle qui était à ma portée, puis quittai les lieux à grands pas rapides. Alors que je m'éloignais, des cris de mécontentement retentirent dans mon dos. Je ne pris pas la peine de regarder ce qui se passait et je me mis à courir comme jamais. Je poursuivais ma course effrénée lorsque je laissai échapper un regard vers l'arrière et je découvris que les deux gardes qui étaient à mes trousses me rattrapaient. Je tournai dans une rue fréquentée. Paniqué, je me glissais entre les personnes qui se rendaient au marché. Au bout de la rue, je vis deux gardes susceptibles de me barrer la route. J'aperçus une avenue à ma droite. Je l'empruntai et courus me cacher dans une grosse malle ornementée de dorures à l'arrière d'un riche carrosse au même ornement. Ma seule issue. L'orange que j'avais glissée dans ma poche ne ressemblait plus à rien.
Le trajet m’avait paru éternel, et, pendant que le cocher invitait les passagers à quitter le véhicule, je me faufilai discrètement hors de la malle. Je me dirigeai en courant vers une grande porte ouverte, quand je m'aperçus que j'étais dans un endroit incroyable. Je me trouvais sur une grande place, devant une immense bâtisse couverte de dorures et de sculptures variées. Je me faufilai à toute vitesse vers la porte que j'avais repérée afin de mieux observer ce lieu où j'arrivais. Des bourgeois se pavanant dans cette cour étaient couverts de bijoux, de soieries et de dentelles. Je ne pouvais détacher mon regard de cette grandiose scène très loin de la rigueur monastique que je connaissais et de l'état des rues que j'avais pu observer auparavant. Je risquai un coup d'œil à l'intérieur et découvris de magnifiques étalons, tous plus propres et majestueux les uns que les autres. Je me rendis alors compte de mon état actuel : j'étais plus sale qu'un cheval et je sentais le chien mouillé et l'orange ! Autour de moi se pressaient des centaines de domestiques attelés à leurs tâches et qui avaient l'air insensibles à l'endroit où ils se trouvaient.
« Toi ! » Ce cri avait fusé en ma direction et je me retournai sous le choc de sa dureté. C'était un homme armé, il était de bonne taille et possédait les muscles de celui qui s'entraîne jour et nuit à l'épée. Je regardai autour de moi, mais personne, non personne ne semblait faire attention à un soldat criant après un jeune homme sale. Il fut tout à coup à côté de moi, me tenant le bras d'une main de fer.
« Oui, toi, répéta-t-il.
-Qu'ai-je fait qui puisse vous déplaire, Messire ? »
Il balaya ma question de sa main libre d'un geste désinvolte Et reprit : « Quel âge as-tu ?
- J’ai 18 ans, répondis-je du tout au tout. Puis-je vous aider, Messire ?
- Oui, c'est le grand recrutement, tu ne le savais pas ? Je croyais pourtant que tu étais venu pour ça. Comment t'appelles-tu?
- Jules, Messire.
- Moi c'est Martin et je suis soldat. Tu seras bien gentil de m'appeler comme cela. Tourne toi... >>
Je ne devais pas aller assez vite à son goût, car il joignit le geste à la parole et me fit tourner sur moi-même. Puis il marmonna :
« Oui, tu seras parfait.
-Pourquoi faire, Mess...Martin ?
-Je te l’ai déjà dit, j'ai besoin d'un écuyer à former comme nous tous ici qui devons préparer l'armée du Roi. J'en cherche un depuis plusieurs jours déjà et je crois que j'ai trouvé mon homme. Tu as une bonne carrure et de l'intelligence dans les yeux en plus ! Suis moi, je vais te présenter au chef et... ton nettoyage... soit, nous passerons aux bains au passage. » Et c'est comme cela que j'arrivai à la cour de Louis XVI !
Je devins officiellement l’apprenti de Martin le soldat. Je m’occupais de son cheval, je faisais son rapport au chef de la garde lorsqu'il n'en avait pas le temps et je transmettais ses lettres aux belles domestiques car, comme tout soldat, Martin ne savait ni lire ni écrire. A propos d'amour, on ne peut pas dire que je n'avais aucun charme. C'est en tous les cas ce que me disait ma belle Juliette. En effet, nous fîmes connaissance lors de mon entrevue avec la chef cuisinière qui ne voulait pas que je prenne à manger pour mon maître et moi. Les cuisines : une grande pièce où cinquante personnes s'activaient. Des denrées de première qualité abondaient dans les casseroles. En effet, la cuisine était si riche que le nombre d'aliments gâchés égalait la quantité de ceux ingérés. Notre Roi, voulant briller de mille éclats, rivalisait avec les dirigeants des autres pays sur ce qu'il y avait de mieux, et mettait son point d'honneur à avoir les meilleurs cuisiniers du monde et faisait venir des fruits des autres continents.
Juliette fut témoin de ma rencontre avec cette femme, ainsi que toutes les jeunes aides de cuisine qui étaient présentes ce jour là pour aider à préparer un banquet. Elles rirent toutes beaucoup devant mon air déconfit... toutes ?! Non, Juliette vint à ma rescousse et me soutint en face de cette femme qui était plus petite que moi mais qui m'effrayait autant qu'un soldat de la meilleure envergure. Depuis ce jour, Juliette et moi ne manquâmes pas de passer tous nos moments « à nous » comme nous les appelâmes si bien, ensemble. Comme je vous le disais, Martin n'avait pas été alphabétisé et c'est pour cela, qu'un soir, il me proposa un marché : « Si tu m'instruis, je t'apprendrai à jouer aux cartes. Tu es futé et tu pourrais très bien t'en sortir ; de même je ne veux pas que tu continues toute ta vie à connaître le contenu de mes missives... amoureuses. » Il hésita et rougit sur cette dernière phrase et je ne le taquinai donc pas comme d’habitude, car à cette époque, ne pas savoir lire ni écrire ne causait pas !a honte d'un homme, mais l'avouer en rougissant si ! Surtout pour un homme de l'envergure de Martin.
La vie continua son cours lent et charmeur à la fois, et je m'extasiais devant la beauté de l'endroit que j'habitais maintenant. Martin commença à bien lire et écrire. Il me dit que mon niveau de joueur de cartes était devenu «in perfectto » ! En effet, je le battis à maintes reprises au cours des soirées que nous passâmes dans la petite maison qu'il possédait en ville. Il devint d'ailleurs clair, un soir, que j'avais atteint un niveau d’« expert ». Il me proposa donc de jouer dans la salle des gardes : « la salle où l'on ne pouvait s'ennuyer si on savait jouer aux cartes. » Il fut prévu que nous y allions le lendemain, à l'heure du repas. Je passai la journée dans un tel état d'excitation que Martin me toucha à maintes reprises lors de notre entraînement à la salle d'escrime. Puis nous allâmes nous laver aux bains.
Je découvris la salle des gardes qui me faisait penser aux écuries du monastère par son architecture longue et étroite. Négligée par la noblesse, elle contrastait avec le reste du palais par son manque de richesses. Pour mobilier, cette salle ne contenait qu'une grande table munie de deux bancs étroits et des murs de pierres : celui du fond supportait deux lances de gardes que recouvrait le blason de Versailles. Ce dernier, seule chose que l'on retrouvait partout et identique dans le château, était en or, le seul métal qui convenait pour des soldats aussi vaillants. Bien que la décoration soit aussi simple, les pots de bière et tout ce qui faisait le festin d'un soldat se trouvaient en abondance sur cette table. Tous dans leurs uniformes rouges, bleus, portaient leurs épaulettes avec fierté.
Ils discutaient et riaient de bon cœur. Ils jouaient aux cartes avec concentration et aucun ne semblait avoir bu de trop. Je m'assis à cette table quand j'y fus convié par un jeune écuyer, comme moi, qui me désigna une place à côté de lui. Nous fîmes quelques parties ensemble, et, n'arrêtant pas de gagner, je devins le centre d'attention. Tous me regardaient jouer avec respect, et j'en pris un plaisir multiplié. Je fis donc d'un pauvre trois de trèfle la meilleure carte du jeu avec habilité et sans tricher !
Martin était parti depuis quelques minutes déjà, quand un homme rentra d'une manière si prétentieuse dans la pièce que je n'en présageais rien de bon. Je fus renforcé dans mes craintes, quand le silence se fit pesant et que mon précédent compagnon de jeu me murmura à l'oreille : « Oh la la, on ne l'attendait pas de si tôt celui là ! » Il ne portait pas les habits d'un soldat, mais ceux d'un seigneur. Il semblait se délecter de ce silence de mort ! Il s'approcha de la table, regarda la mise que j'avais accumulée depuis le début de la partie. Il s'assit en face de moi, misa, et sans plus de cérémonie, fit le signe pour qu'on distribue les cartes pour nous deux. Plus aucun son ne s'entendit, et cela devint vraiment pesant. Tous ces bons hommes ne m'observaient plus avec respect, mais avec compassion et inquiétude. L'homme au visage bouffi d'orgueil, assis en face de moi, regarda son jeu d'un air calculateur. Je jetai un coup d'œil au mien et misai à mon tour. Derrière lui s'étaient groupés les hommes qui le soutenaient et qui, en cas de bagarre, le défendraient. Je risquai un coup d'œil derrière moi et y trouvai des regards qui se voulurent encourageants. Puis la partie commença. Peu à peu pris dans l'enthousiasme du jeu, j'en oubliai mes précédentes craintes. L'adversaire en face de moi sembla monter en rage, perdant la partie. Étant impassible, je fus surpris quand le perdant m'attaqua et me donna un coup à l'épaule. Ce geste déclencha une rixe générale. Fou de rage, il commença à me frapper plus fort encore. Paniquant, je me ruai hors de cette salle bruyante, poursuivi par un « taureau enragé ».
Je m'aventurai dans les célèbres labyrinthes des jardins. Je les connaissais comme ma poche à force d'y passer le plus clair de mon temps avec Juliette. Je fus une fois encore frappé de leur beauté. Ils me semblaient bien plus beaux que sur les enluminures qui les représentaient au monastère. Par leur cubisme, on voyait qu'ils avaient été taillés avec soin et minutie. Voyant qu'il me perdait de vue, je me dirigeai dans l'allée principale, et continuai d'avancer en direction du château. La nuit tombante me cacha les trois gardes qui me barrèrent le chemin. Surpris dans l’élan de ma course, mes pieds prirent la malheureuse initiative de s’arrêter. Le reste de mon corps ne fut pas en accord avec cette décision, et continua d'avancer. Projeté en avant, j'atterris sur mon postérieur. Je regardai en l'air et m'aperçus du regard rieur des trois hommes posés sur moi. Je me levai avant qu'ils ne prennent l'initiative de le faire avec leur douceur légendaire. Le « taureau enragé » plutôt trempé avait dû faire un tour dans la fontaine « Roi Soleil », avant de nous rattraper sur le chemin. Les deux autres gardes libres se saisirent de lui, puis nous jetèrent tous deux dans l'un des cachots humides et froids du palais, dans les profondeurs de celui-ci. Je me réveillai plusieurs fois dans la nuit à cause du froid mordant ma peau. Mon adversaire, lui, dormit sans encombre, ce qui était normal puisqu'il avait pris l'unique botte de paille de la geôle. Ce fut pour moi une chance d'échapper à ses mains de fer.
Deux gardes vinrent nous chercher aux premières heures du jour, un air neutre sur le visage. Nous traversâmes bon nombre de couloirs et de pièces. Parmi lesquelles, la galerie des glaces : des centaines de miroirs étaient disposés de part et d'autre de la pièce. Des peintures magnifiques recouvraient le plafond, et chaque lustre était de cristal. Ce couloir réunissait toutes les richesses qui pouvaient trouver leur place à Versailles : or, marbre, peintures et cristal. Après maintes montées, descentes d'escaliers et beaucoup de patience, nous arrivâmes enfin devant une grande porte. Cette pièce refermait des trésors par quantité. Jusqu'à la poignée de porte était travaillée avec habilité et goût. Les murs étaient peints par les plus grands peintres. Tout était en or, tapisseries, sculptures... Par la fenêtre l'on voyait les jardins et leurs fontaines. Le château de Versailles était une œuvre d'art en lui-même. A en deviner par le grand fauteuil recouvert de draps et de tentures, et dont les accoudoirs étaient en or massif, je devais me trouver dans la salle du trône. Nous la traversâmes pour rentrer dans la pièce située au fond. Elle avait une petite taille, mais était avantagée par ses élégants tissus. Louis XVI assis dans un fauteuil, opta pour une pose toute étudiée. Lorsque son valet nous annonça, Sa Majesté leva le visage d'un air fâché. Je fus impressionné de voir le Roi. Puis, se levant, il vint au devant de nous, et dit avec colère : « Alors voici nos hommes, ceux qui s'amusent à faire combattre les servants du roi ! Est-ce bien vous qui avez déclenché cette grosse bagarre ? Qu'est-ce que votre raison dans cette situation ? Les soldats de ce château ont d'autres choses à faire que de faire... les pitres. » Nous ouvrîmes tous deux la bouche pour répondre à cette interrogation, mais notre roi nous interrompit : « Ne vous fatiguez point, j'en connais l'explication. Elle m'est venue de cette jeune fille. » Juliette sortit alors de derrière l'une de ces tentures pourpres cousues de fils d'or puis vint se placer à côté de moi, glissant sa main dans la mienne.
. Un sourire amusé sur les lèvres, ce Noble homme reprit : « Elle n'était pas présente lors de la scène, m’a-t-elle dit, mais une amie qui servait ces hommes la lui a décrite. Vous pouvez la remercier, mes bons messieurs. Vous avez de la chance que j'aime à jouer aux cartes. Tout autant que la Cour de Versailles n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, où vous auriez séjourné durant plus d'une nuit dans ses geôles. Je perds de mon autorité et le peuple commence à se révolter. J'ai bien peur que mes beaux printemps au trône ne me soient comptés... Je me noie donc, outre mes heures de règne acharné, dans toutes sortes de divertissements, comme celui de regarder deux chenapans jouer aux cartes. » Puis, après un long soupir, il reprit : « Mais qui est le meilleur ? Il nous indiqua une table comportant quatre chaises et... un paquet de cartes à jouer. Nous prîmes chacun place autour de cette table en marqueterie. Il distribua le paquet entre mon « ennemi » et moi, puis nous dit l'air très content de lui : « A vous de jouer ! » Puis plus bas : « Il est sûr entre nous que le gagnant deviendra le joueur attitré de la cour de Versailles. Le perdant devra bien entendu travailler aux écuries durant un temps... indéterminé ! » Malgré le froid que cette déclaration avait mis en moi, je ne pus m'empêcher d'être, une fois encore, transporté dans un autre monde. Je sortis les cartes une à une de mon jeu, très sûr de moi.
Tout à coup, un trèfle apparaît sur la nappe brodée. Mais pas du mien. Je revins à la réalité, et m'aperçus que Juliette regarde les cartes d'un air navré. Je les regardai à mon tour. Je perdis. Tous mes espoirs d'avenir, de chance et caetera tombèrent à l'eau. A la place, les écuries m'attendaient ! Mon regard fut attiré sur mon côté droit. Juliette faisait face au gagnant. Mais qu'importait ?
« J'ai perdu et elle ne pourra le changer. » pensai-je dans mon désespoir. Un cri totalement féminin sortit alors de la bouche caractérisée du taureau encore enragé. Juliette lui a relevé les manches et un flot de cartes en découle. Je me tournai donc vers Louis XVI avec un air ébahi sur le visage. Il eût la même expression. Ma tête me fit mal à force de tant de péripéties et je ne savais plus que faire. Je jetai un coup d'œil à Juliette qui m'en rendit un encourageant. Ça me redonna confiance et je me tournai vers mon Roi. « Qui est donc le gagnant, Majesté ?
-Mais tu es modeste en plus. Bien sûr que c'est toi ! Le meilleur joueur de cartes de la cour de Versailles se doit de jouer honnêtement ! »
Cette seule phrase de Louis XVI me conforta dans l'idée que j'avais eu raison de quitter la vie bien ordonnée du monastère, et voilà jusqu'où peut mener le vol d'une orange...
Le trajet m’avait paru éternel, et, pendant que le cocher invitait les passagers à quitter le véhicule, je me faufilai discrètement hors de la malle. Je me dirigeai en courant vers une grande porte ouverte, quand je m'aperçus que j'étais dans un endroit incroyable. Je me trouvais sur une grande place, devant une immense bâtisse couverte de dorures et de sculptures variées. Je me faufilai à toute vitesse vers la porte que j'avais repérée afin de mieux observer ce lieu où j'arrivais. Des bourgeois se pavanant dans cette cour étaient couverts de bijoux, de soieries et de dentelles. Je ne pouvais détacher mon regard de cette grandiose scène très loin de la rigueur monastique que je connaissais et de l'état des rues que j'avais pu observer auparavant. Je risquai un coup d'œil à l'intérieur et découvris de magnifiques étalons, tous plus propres et majestueux les uns que les autres. Je me rendis alors compte de mon état actuel : j'étais plus sale qu'un cheval et je sentais le chien mouillé et l'orange ! Autour de moi se pressaient des centaines de domestiques attelés à leurs tâches et qui avaient l'air insensibles à l'endroit où ils se trouvaient.
« Toi ! » Ce cri avait fusé en ma direction et je me retournai sous le choc de sa dureté. C'était un homme armé, il était de bonne taille et possédait les muscles de celui qui s'entraîne jour et nuit à l'épée. Je regardai autour de moi, mais personne, non personne ne semblait faire attention à un soldat criant après un jeune homme sale. Il fut tout à coup à côté de moi, me tenant le bras d'une main de fer.
« Oui, toi, répéta-t-il.
-Qu'ai-je fait qui puisse vous déplaire, Messire ? »
Il balaya ma question de sa main libre d'un geste désinvolte Et reprit : « Quel âge as-tu ?
- J’ai 18 ans, répondis-je du tout au tout. Puis-je vous aider, Messire ?
- Oui, c'est le grand recrutement, tu ne le savais pas ? Je croyais pourtant que tu étais venu pour ça. Comment t'appelles-tu?
- Jules, Messire.
- Moi c'est Martin et je suis soldat. Tu seras bien gentil de m'appeler comme cela. Tourne toi... >>
Je ne devais pas aller assez vite à son goût, car il joignit le geste à la parole et me fit tourner sur moi-même. Puis il marmonna :
« Oui, tu seras parfait.
-Pourquoi faire, Mess...Martin ?
-Je te l’ai déjà dit, j'ai besoin d'un écuyer à former comme nous tous ici qui devons préparer l'armée du Roi. J'en cherche un depuis plusieurs jours déjà et je crois que j'ai trouvé mon homme. Tu as une bonne carrure et de l'intelligence dans les yeux en plus ! Suis moi, je vais te présenter au chef et... ton nettoyage... soit, nous passerons aux bains au passage. » Et c'est comme cela que j'arrivai à la cour de Louis XVI !
Je devins officiellement l’apprenti de Martin le soldat. Je m’occupais de son cheval, je faisais son rapport au chef de la garde lorsqu'il n'en avait pas le temps et je transmettais ses lettres aux belles domestiques car, comme tout soldat, Martin ne savait ni lire ni écrire. A propos d'amour, on ne peut pas dire que je n'avais aucun charme. C'est en tous les cas ce que me disait ma belle Juliette. En effet, nous fîmes connaissance lors de mon entrevue avec la chef cuisinière qui ne voulait pas que je prenne à manger pour mon maître et moi. Les cuisines : une grande pièce où cinquante personnes s'activaient. Des denrées de première qualité abondaient dans les casseroles. En effet, la cuisine était si riche que le nombre d'aliments gâchés égalait la quantité de ceux ingérés. Notre Roi, voulant briller de mille éclats, rivalisait avec les dirigeants des autres pays sur ce qu'il y avait de mieux, et mettait son point d'honneur à avoir les meilleurs cuisiniers du monde et faisait venir des fruits des autres continents.
Juliette fut témoin de ma rencontre avec cette femme, ainsi que toutes les jeunes aides de cuisine qui étaient présentes ce jour là pour aider à préparer un banquet. Elles rirent toutes beaucoup devant mon air déconfit... toutes ?! Non, Juliette vint à ma rescousse et me soutint en face de cette femme qui était plus petite que moi mais qui m'effrayait autant qu'un soldat de la meilleure envergure. Depuis ce jour, Juliette et moi ne manquâmes pas de passer tous nos moments « à nous » comme nous les appelâmes si bien, ensemble. Comme je vous le disais, Martin n'avait pas été alphabétisé et c'est pour cela, qu'un soir, il me proposa un marché : « Si tu m'instruis, je t'apprendrai à jouer aux cartes. Tu es futé et tu pourrais très bien t'en sortir ; de même je ne veux pas que tu continues toute ta vie à connaître le contenu de mes missives... amoureuses. » Il hésita et rougit sur cette dernière phrase et je ne le taquinai donc pas comme d’habitude, car à cette époque, ne pas savoir lire ni écrire ne causait pas !a honte d'un homme, mais l'avouer en rougissant si ! Surtout pour un homme de l'envergure de Martin.
La vie continua son cours lent et charmeur à la fois, et je m'extasiais devant la beauté de l'endroit que j'habitais maintenant. Martin commença à bien lire et écrire. Il me dit que mon niveau de joueur de cartes était devenu «in perfectto » ! En effet, je le battis à maintes reprises au cours des soirées que nous passâmes dans la petite maison qu'il possédait en ville. Il devint d'ailleurs clair, un soir, que j'avais atteint un niveau d’« expert ». Il me proposa donc de jouer dans la salle des gardes : « la salle où l'on ne pouvait s'ennuyer si on savait jouer aux cartes. » Il fut prévu que nous y allions le lendemain, à l'heure du repas. Je passai la journée dans un tel état d'excitation que Martin me toucha à maintes reprises lors de notre entraînement à la salle d'escrime. Puis nous allâmes nous laver aux bains.
Je découvris la salle des gardes qui me faisait penser aux écuries du monastère par son architecture longue et étroite. Négligée par la noblesse, elle contrastait avec le reste du palais par son manque de richesses. Pour mobilier, cette salle ne contenait qu'une grande table munie de deux bancs étroits et des murs de pierres : celui du fond supportait deux lances de gardes que recouvrait le blason de Versailles. Ce dernier, seule chose que l'on retrouvait partout et identique dans le château, était en or, le seul métal qui convenait pour des soldats aussi vaillants. Bien que la décoration soit aussi simple, les pots de bière et tout ce qui faisait le festin d'un soldat se trouvaient en abondance sur cette table. Tous dans leurs uniformes rouges, bleus, portaient leurs épaulettes avec fierté.
Ils discutaient et riaient de bon cœur. Ils jouaient aux cartes avec concentration et aucun ne semblait avoir bu de trop. Je m'assis à cette table quand j'y fus convié par un jeune écuyer, comme moi, qui me désigna une place à côté de lui. Nous fîmes quelques parties ensemble, et, n'arrêtant pas de gagner, je devins le centre d'attention. Tous me regardaient jouer avec respect, et j'en pris un plaisir multiplié. Je fis donc d'un pauvre trois de trèfle la meilleure carte du jeu avec habilité et sans tricher !
Martin était parti depuis quelques minutes déjà, quand un homme rentra d'une manière si prétentieuse dans la pièce que je n'en présageais rien de bon. Je fus renforcé dans mes craintes, quand le silence se fit pesant et que mon précédent compagnon de jeu me murmura à l'oreille : « Oh la la, on ne l'attendait pas de si tôt celui là ! » Il ne portait pas les habits d'un soldat, mais ceux d'un seigneur. Il semblait se délecter de ce silence de mort ! Il s'approcha de la table, regarda la mise que j'avais accumulée depuis le début de la partie. Il s'assit en face de moi, misa, et sans plus de cérémonie, fit le signe pour qu'on distribue les cartes pour nous deux. Plus aucun son ne s'entendit, et cela devint vraiment pesant. Tous ces bons hommes ne m'observaient plus avec respect, mais avec compassion et inquiétude. L'homme au visage bouffi d'orgueil, assis en face de moi, regarda son jeu d'un air calculateur. Je jetai un coup d'œil au mien et misai à mon tour. Derrière lui s'étaient groupés les hommes qui le soutenaient et qui, en cas de bagarre, le défendraient. Je risquai un coup d'œil derrière moi et y trouvai des regards qui se voulurent encourageants. Puis la partie commença. Peu à peu pris dans l'enthousiasme du jeu, j'en oubliai mes précédentes craintes. L'adversaire en face de moi sembla monter en rage, perdant la partie. Étant impassible, je fus surpris quand le perdant m'attaqua et me donna un coup à l'épaule. Ce geste déclencha une rixe générale. Fou de rage, il commença à me frapper plus fort encore. Paniquant, je me ruai hors de cette salle bruyante, poursuivi par un « taureau enragé ».
Je m'aventurai dans les célèbres labyrinthes des jardins. Je les connaissais comme ma poche à force d'y passer le plus clair de mon temps avec Juliette. Je fus une fois encore frappé de leur beauté. Ils me semblaient bien plus beaux que sur les enluminures qui les représentaient au monastère. Par leur cubisme, on voyait qu'ils avaient été taillés avec soin et minutie. Voyant qu'il me perdait de vue, je me dirigeai dans l'allée principale, et continuai d'avancer en direction du château. La nuit tombante me cacha les trois gardes qui me barrèrent le chemin. Surpris dans l’élan de ma course, mes pieds prirent la malheureuse initiative de s’arrêter. Le reste de mon corps ne fut pas en accord avec cette décision, et continua d'avancer. Projeté en avant, j'atterris sur mon postérieur. Je regardai en l'air et m'aperçus du regard rieur des trois hommes posés sur moi. Je me levai avant qu'ils ne prennent l'initiative de le faire avec leur douceur légendaire. Le « taureau enragé » plutôt trempé avait dû faire un tour dans la fontaine « Roi Soleil », avant de nous rattraper sur le chemin. Les deux autres gardes libres se saisirent de lui, puis nous jetèrent tous deux dans l'un des cachots humides et froids du palais, dans les profondeurs de celui-ci. Je me réveillai plusieurs fois dans la nuit à cause du froid mordant ma peau. Mon adversaire, lui, dormit sans encombre, ce qui était normal puisqu'il avait pris l'unique botte de paille de la geôle. Ce fut pour moi une chance d'échapper à ses mains de fer.
Deux gardes vinrent nous chercher aux premières heures du jour, un air neutre sur le visage. Nous traversâmes bon nombre de couloirs et de pièces. Parmi lesquelles, la galerie des glaces : des centaines de miroirs étaient disposés de part et d'autre de la pièce. Des peintures magnifiques recouvraient le plafond, et chaque lustre était de cristal. Ce couloir réunissait toutes les richesses qui pouvaient trouver leur place à Versailles : or, marbre, peintures et cristal. Après maintes montées, descentes d'escaliers et beaucoup de patience, nous arrivâmes enfin devant une grande porte. Cette pièce refermait des trésors par quantité. Jusqu'à la poignée de porte était travaillée avec habilité et goût. Les murs étaient peints par les plus grands peintres. Tout était en or, tapisseries, sculptures... Par la fenêtre l'on voyait les jardins et leurs fontaines. Le château de Versailles était une œuvre d'art en lui-même. A en deviner par le grand fauteuil recouvert de draps et de tentures, et dont les accoudoirs étaient en or massif, je devais me trouver dans la salle du trône. Nous la traversâmes pour rentrer dans la pièce située au fond. Elle avait une petite taille, mais était avantagée par ses élégants tissus. Louis XVI assis dans un fauteuil, opta pour une pose toute étudiée. Lorsque son valet nous annonça, Sa Majesté leva le visage d'un air fâché. Je fus impressionné de voir le Roi. Puis, se levant, il vint au devant de nous, et dit avec colère : « Alors voici nos hommes, ceux qui s'amusent à faire combattre les servants du roi ! Est-ce bien vous qui avez déclenché cette grosse bagarre ? Qu'est-ce que votre raison dans cette situation ? Les soldats de ce château ont d'autres choses à faire que de faire... les pitres. » Nous ouvrîmes tous deux la bouche pour répondre à cette interrogation, mais notre roi nous interrompit : « Ne vous fatiguez point, j'en connais l'explication. Elle m'est venue de cette jeune fille. » Juliette sortit alors de derrière l'une de ces tentures pourpres cousues de fils d'or puis vint se placer à côté de moi, glissant sa main dans la mienne.
. Un sourire amusé sur les lèvres, ce Noble homme reprit : « Elle n'était pas présente lors de la scène, m’a-t-elle dit, mais une amie qui servait ces hommes la lui a décrite. Vous pouvez la remercier, mes bons messieurs. Vous avez de la chance que j'aime à jouer aux cartes. Tout autant que la Cour de Versailles n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, où vous auriez séjourné durant plus d'une nuit dans ses geôles. Je perds de mon autorité et le peuple commence à se révolter. J'ai bien peur que mes beaux printemps au trône ne me soient comptés... Je me noie donc, outre mes heures de règne acharné, dans toutes sortes de divertissements, comme celui de regarder deux chenapans jouer aux cartes. » Puis, après un long soupir, il reprit : « Mais qui est le meilleur ? Il nous indiqua une table comportant quatre chaises et... un paquet de cartes à jouer. Nous prîmes chacun place autour de cette table en marqueterie. Il distribua le paquet entre mon « ennemi » et moi, puis nous dit l'air très content de lui : « A vous de jouer ! » Puis plus bas : « Il est sûr entre nous que le gagnant deviendra le joueur attitré de la cour de Versailles. Le perdant devra bien entendu travailler aux écuries durant un temps... indéterminé ! » Malgré le froid que cette déclaration avait mis en moi, je ne pus m'empêcher d'être, une fois encore, transporté dans un autre monde. Je sortis les cartes une à une de mon jeu, très sûr de moi.
Tout à coup, un trèfle apparaît sur la nappe brodée. Mais pas du mien. Je revins à la réalité, et m'aperçus que Juliette regarde les cartes d'un air navré. Je les regardai à mon tour. Je perdis. Tous mes espoirs d'avenir, de chance et caetera tombèrent à l'eau. A la place, les écuries m'attendaient ! Mon regard fut attiré sur mon côté droit. Juliette faisait face au gagnant. Mais qu'importait ?
« J'ai perdu et elle ne pourra le changer. » pensai-je dans mon désespoir. Un cri totalement féminin sortit alors de la bouche caractérisée du taureau encore enragé. Juliette lui a relevé les manches et un flot de cartes en découle. Je me tournai donc vers Louis XVI avec un air ébahi sur le visage. Il eût la même expression. Ma tête me fit mal à force de tant de péripéties et je ne savais plus que faire. Je jetai un coup d'œil à Juliette qui m'en rendit un encourageant. Ça me redonna confiance et je me tournai vers mon Roi. « Qui est donc le gagnant, Majesté ?
-Mais tu es modeste en plus. Bien sûr que c'est toi ! Le meilleur joueur de cartes de la cour de Versailles se doit de jouer honnêtement ! »
Cette seule phrase de Louis XVI me conforta dans l'idée que j'avais eu raison de quitter la vie bien ordonnée du monastère, et voilà jusqu'où peut mener le vol d'une orange...
Cette œuvre n'est que fiction ! Vous ne vous retrouverez pas à Versailles, à l'époque de Louis XVI, en volant un Cocaution chez Géant-Casino. Non plus joueur de cartes au Palais de l’Elysée
Niveau 3e
Sujet 1
Pauline DEGUT (Pau 71)
Collège Notre-Dame de Varanges - Givry
Une vie à contre-jour
Le soleil éclaire encore timidement les feuillages du jardin. C'est la fin de l'été. J'ai jeté un vieux châle sur mes épaules et me suis assise sur le fauteuil de la véranda. J'aime tant ces chaudes journées passées à l'ombre. Il n'y a rien de mieux que le chant des oiseaux et la senteur des fleurs.
Au fond de la cour, à côté du petit cerisier, le portail s'ouvre doucement. J'entrevois le visage de ma petite fille, ma Lisa ; je reconnais aussi la démarche enjouée d'Antoine, son frère, qui la suit de près. Ils s'avancent dans l'allée à grands pas. Quelle joie pour moi de les revoir ! Ils sont tout ce qu'il me reste, tout ce pour quoi je me suis battue auparavant. Lisa m'étreint en riant, et Antoine se contente de m'embrasser sur la joue. L'insouciance se lit dans leurs yeux. Non, rien ne les tracasse, rien ne les atteint.
Antoine s'assoit, Lisa l'imite. Nous voici tous les trois. Je propose un verre de citronnade, une part de gâteau, mais ils refusent poliment : « grand-mère, si nous sommes venus te voir, c'est parce que nous avons un devoir à rendre la semaine prochaine, on voudrait que tu nous aides ».
Je les questionne, sur quoi cela peut-il bien porter ? La cuisine, la botanique, ou même l'éducation ?
« La guerre, grand-mère, la guerre », se lance Antoine.
Je manque de m'évanouir. Comment ose-t-il ? Comment pourrais-je en parler, moi, moi dont l'époux est mort d'un obus dans le ventre ? Il faudra pourtant que je me surpasse. Je ne peux rien refuser à mes petits enfants.
Mais non, je n'en suis pas capable. Je n'ai jamais vraiment fait mon deuil, la guerre m'a enlevé ce que j'avais de plus cher au monde, ma raison de vivre... oh, j'ai toujours été forte, pourquoi ne le serais-je plus maintenant ? Allons, un peu de courage !
Lisa sort des feuilles et un crayon, et pose sur moi un regard insistant. Antoine quant à lui est resté silencieux. Je lui souris. Un sourire discret, un sourire sincère.
« - Grand-mère, il nous faut une sorte de témoignage, quelque chose de marquant tu comprends ?
- Oui voilà, quelque chose de vrai » renchérit Lisa.
J'inspire, ferme les yeux quelques secondes. Je fais un effort surhumain pour ne pas montrer mon désarroi. Je suis contrainte de raconter ce que j'ai tenté d'oublier durant toutes ces années. J'avais cru pouvoir vivre presque sereinement avec ce poids dans le cœur, naïve que je suis. Il n'y a que la souffrance qui dure éternellement.
Je pose mon châle sur le dossier de la chaise. Et puis je raconte. Je raconte tout, je ne m'arrête plus. Je me vide de tous ces souvenirs accumulés années après années. Je leur parle des premières lettres entre Edouard et moi, après son départ. Les illusions d'un retour imminent, des projets insouciants que nous avions établis.
Mon Edouard, leur grand-père, qu'ils n'auront jamais connu. Lorsqu'il est parti, j'étais encore enceinte de leur oncle, Louis. Il m'envoyait des lettres tous les deux jours, et m'écrivait dans le train qui les menait à travers le pays. Il me décrivait les paysages qu'il rencontrait, les rencontres qu'il faisait de gare en gare. Il embrassait nos six enfants, leur disait de bien travailler, de prendre soin de moi, de m'aider. Il passait le bonjour à l'épicière, et au curé du village. Nos lettres étaient des plus communes, sans une once de crainte. Il parlait d'acheter une maison dans le Sud à son retour, pour élever convenablement les enfants et avoir une exploitation agricole plus conséquente. Il voulait acheter de nombreux animaux, des plantations aussi.
Mais savait-il alors qu'il ne reviendrait jamais? Etait-il conscient qu'il allait mourir le 16 avril1917, lors de l'offensive du Chemin des Dames ? Non, certainement pas. Oh mon Edouard, pourquoi me l'ont ils pris ?
Antoine me caresse tendrement la main. Lisa tremble presque ; je ne leur avais jamais parlé de leur grand-père avant aujourd'hui. Je me calme lentement, et refoule une colère encore présente. Je change subtilement de sujet, et me mets à leur parler de ma vie en l'absence d'Edouard. J'énumère chaque jour de la semaine, péniblement. Le lundi, j'allais au bourg du village qui se trouvait à deux kilomètres de la maison. J'achetais toujours un paquet de papier à lettres, et huit timbres à la poste. J'en profitais pour acheter du café bien fort et des chocolats à envoyer à Edouard, dans de petits cartons imperméabilisés que nous fournissaient les officiers de passage dans la région. Le mardi, toutes les femmes des alentours se réunissaient dans une petite salle derrière l'église pour préparer les colis à envoyer aux soldats. Je ne m'y rendais qu'une fois par mois, leurs commérages futiles m'exaspéraient. Les autres jours, je me débrouillais pour que mon colis parvienne à Edouard par le biais d'un ami douanier. Le mercredi, je passais souvent l'après-midi chez une amie, au bout de la rue. Elle avait une radio, alors nous écoutions les dernières nouvelles des soldats au front. Parfois, la peur nous gagnait quand nous apprenions l'avancée des Allemands, mais maintes fois nous sautâmes de joie à l'écoute des succès de l'armée française qui regagnait du terrain. Le jeudi, je passais la journée à ranger la maison, et le vendredi je retournais au bourg réceptionner mon courrier.
Bien sûr, hormis ces activités hebdomadaires, une chose m'occupait plus que toutes les autres : la ferme familiale. Je crois que c'est ce qui a été le plus dur après le départ d'Edouard. Chaque matin, j'étais levée aux aurores pour aller panser les animaux, pendant qu'Antonin emmenait paître les vaches. Je brossais les chevaux, nourrissais les poules, soignais les lapins... j'effectuais des tâches pénibles, et bien trop dures pour une femme de ma physionomie. Je continuais d'engraisser quelques cochons pour pouvoir les tuer aux alentours de Noël afin de pouvoir manger des saucisses et du jambon tout au long de l'année. Les jours se ressemblaient tous, monotones, vides d'espoir. Je me couchais chaque soir harassée par tant de travail, par tant d'efforts accomplis. Louise, ma plus grande fille, âgée de quinze ans, m'aidait parfois, mais elle était encore plus frêle que moi, la pauvre enfant. Mes marmots ne m'accompagnaient jamais lors de mes déplacements, excepté le dimanche pour la grand-messe. Je redoutais les assemblées qui suivaient sur la place de l'église car les veuves éplorées du village étaient un bien triste spectacle.
Au fond de la cour, à côté du petit cerisier, le portail s'ouvre doucement. J'entrevois le visage de ma petite fille, ma Lisa ; je reconnais aussi la démarche enjouée d'Antoine, son frère, qui la suit de près. Ils s'avancent dans l'allée à grands pas. Quelle joie pour moi de les revoir ! Ils sont tout ce qu'il me reste, tout ce pour quoi je me suis battue auparavant. Lisa m'étreint en riant, et Antoine se contente de m'embrasser sur la joue. L'insouciance se lit dans leurs yeux. Non, rien ne les tracasse, rien ne les atteint.
Antoine s'assoit, Lisa l'imite. Nous voici tous les trois. Je propose un verre de citronnade, une part de gâteau, mais ils refusent poliment : « grand-mère, si nous sommes venus te voir, c'est parce que nous avons un devoir à rendre la semaine prochaine, on voudrait que tu nous aides ».
Je les questionne, sur quoi cela peut-il bien porter ? La cuisine, la botanique, ou même l'éducation ?
« La guerre, grand-mère, la guerre », se lance Antoine.
Je manque de m'évanouir. Comment ose-t-il ? Comment pourrais-je en parler, moi, moi dont l'époux est mort d'un obus dans le ventre ? Il faudra pourtant que je me surpasse. Je ne peux rien refuser à mes petits enfants.
Mais non, je n'en suis pas capable. Je n'ai jamais vraiment fait mon deuil, la guerre m'a enlevé ce que j'avais de plus cher au monde, ma raison de vivre... oh, j'ai toujours été forte, pourquoi ne le serais-je plus maintenant ? Allons, un peu de courage !
Lisa sort des feuilles et un crayon, et pose sur moi un regard insistant. Antoine quant à lui est resté silencieux. Je lui souris. Un sourire discret, un sourire sincère.
« - Grand-mère, il nous faut une sorte de témoignage, quelque chose de marquant tu comprends ?
- Oui voilà, quelque chose de vrai » renchérit Lisa.
J'inspire, ferme les yeux quelques secondes. Je fais un effort surhumain pour ne pas montrer mon désarroi. Je suis contrainte de raconter ce que j'ai tenté d'oublier durant toutes ces années. J'avais cru pouvoir vivre presque sereinement avec ce poids dans le cœur, naïve que je suis. Il n'y a que la souffrance qui dure éternellement.
Je pose mon châle sur le dossier de la chaise. Et puis je raconte. Je raconte tout, je ne m'arrête plus. Je me vide de tous ces souvenirs accumulés années après années. Je leur parle des premières lettres entre Edouard et moi, après son départ. Les illusions d'un retour imminent, des projets insouciants que nous avions établis.
Mon Edouard, leur grand-père, qu'ils n'auront jamais connu. Lorsqu'il est parti, j'étais encore enceinte de leur oncle, Louis. Il m'envoyait des lettres tous les deux jours, et m'écrivait dans le train qui les menait à travers le pays. Il me décrivait les paysages qu'il rencontrait, les rencontres qu'il faisait de gare en gare. Il embrassait nos six enfants, leur disait de bien travailler, de prendre soin de moi, de m'aider. Il passait le bonjour à l'épicière, et au curé du village. Nos lettres étaient des plus communes, sans une once de crainte. Il parlait d'acheter une maison dans le Sud à son retour, pour élever convenablement les enfants et avoir une exploitation agricole plus conséquente. Il voulait acheter de nombreux animaux, des plantations aussi.
Mais savait-il alors qu'il ne reviendrait jamais? Etait-il conscient qu'il allait mourir le 16 avril1917, lors de l'offensive du Chemin des Dames ? Non, certainement pas. Oh mon Edouard, pourquoi me l'ont ils pris ?
Antoine me caresse tendrement la main. Lisa tremble presque ; je ne leur avais jamais parlé de leur grand-père avant aujourd'hui. Je me calme lentement, et refoule une colère encore présente. Je change subtilement de sujet, et me mets à leur parler de ma vie en l'absence d'Edouard. J'énumère chaque jour de la semaine, péniblement. Le lundi, j'allais au bourg du village qui se trouvait à deux kilomètres de la maison. J'achetais toujours un paquet de papier à lettres, et huit timbres à la poste. J'en profitais pour acheter du café bien fort et des chocolats à envoyer à Edouard, dans de petits cartons imperméabilisés que nous fournissaient les officiers de passage dans la région. Le mardi, toutes les femmes des alentours se réunissaient dans une petite salle derrière l'église pour préparer les colis à envoyer aux soldats. Je ne m'y rendais qu'une fois par mois, leurs commérages futiles m'exaspéraient. Les autres jours, je me débrouillais pour que mon colis parvienne à Edouard par le biais d'un ami douanier. Le mercredi, je passais souvent l'après-midi chez une amie, au bout de la rue. Elle avait une radio, alors nous écoutions les dernières nouvelles des soldats au front. Parfois, la peur nous gagnait quand nous apprenions l'avancée des Allemands, mais maintes fois nous sautâmes de joie à l'écoute des succès de l'armée française qui regagnait du terrain. Le jeudi, je passais la journée à ranger la maison, et le vendredi je retournais au bourg réceptionner mon courrier.
Bien sûr, hormis ces activités hebdomadaires, une chose m'occupait plus que toutes les autres : la ferme familiale. Je crois que c'est ce qui a été le plus dur après le départ d'Edouard. Chaque matin, j'étais levée aux aurores pour aller panser les animaux, pendant qu'Antonin emmenait paître les vaches. Je brossais les chevaux, nourrissais les poules, soignais les lapins... j'effectuais des tâches pénibles, et bien trop dures pour une femme de ma physionomie. Je continuais d'engraisser quelques cochons pour pouvoir les tuer aux alentours de Noël afin de pouvoir manger des saucisses et du jambon tout au long de l'année. Les jours se ressemblaient tous, monotones, vides d'espoir. Je me couchais chaque soir harassée par tant de travail, par tant d'efforts accomplis. Louise, ma plus grande fille, âgée de quinze ans, m'aidait parfois, mais elle était encore plus frêle que moi, la pauvre enfant. Mes marmots ne m'accompagnaient jamais lors de mes déplacements, excepté le dimanche pour la grand-messe. Je redoutais les assemblées qui suivaient sur la place de l'église car les veuves éplorées du village étaient un bien triste spectacle.
Puis Lisa me questionne sur son père, Benoît, qui avait alors trois ans :
« Grand-mère, est-ce que papa te demandait où était grand-père parfois ? ».
Je réponds que non, qu'il ne se rendait compte de rien. Mais au fond, je savais pertinemment que j'avais menti aux enfants... j'avais déguisé le départ brutal de leur père en une envie de voyage soudaine et imprévue. Ils y avaient cru, confiants et certains de son retour. Et moi je vivais dans la honte de mon mensonge, dans la peur de la mort, dans l'anxiété du futur. Qu'allais-je bien pouvoir faire sans mon mari ? Je ne savais pas bien m'occuper des bêtes, et ce n'était pas mes jumeaux de dix ans, Pierre et Jean-Baptiste, qui allaient pouvoir assumer autant de travail quotidiennement. De plus, je m'efforçais d'apprendre à lire, écrire et compter à mes enfants ; ils n'allaient pas à l'école, la plus proche était en ville, à dix-huit kilomètres de la ferme.
Les dettes commençaient à arriver, je ne pouvais plus payer tous mes achats. Chaque semaine, je faisais cinq ou six pains, et deux plaquettes de beurre. Nous ne mangions plus que des pommes de terre, et parfois un morceau de viande quand la bouchère était charitable.
Et la vie suivait son cour, toujours plus dure.
Un soir de Noël 1916, je me souviens avoir reçu une lettre d'Edouard. Il disait aller bien, mais s'être cassé la jambe gauche. Il nous souhaitait un joyeux Noël, et promettait de ramener des cadeaux aux enfants. Tout en bas de la lettre, il m'avait écrit : « Ma Thérèse, prends bien soin de toi. Les officiers envisagent de me laisser revenir quelques jours, au mois de mai. La ferme me manque, les enfants me manquent, tu me manques. Comment vas-tu ? N'oublie pas, ne vends jamais nos vaches, même si l'argent vient à manquer. Je t'embrasse. Ton mari. ». Cette lettre m'avait redonné espoir. Je me voyais déjà accourir dans ses bras, le serrer de toutes mes forces lors de son retour à la maison. J'imaginais déjà une soirée autour du feu, à se raconter des histoires et à chanter de vieilles chansons. Je rêvais de son retour, je ne voulais plus que cela. J'avais tant besoin de lui. Mon pauvre homme. S'il avait su.
« Grand-mère, est-ce que papa te demandait où était grand-père parfois ? ».
Je réponds que non, qu'il ne se rendait compte de rien. Mais au fond, je savais pertinemment que j'avais menti aux enfants... j'avais déguisé le départ brutal de leur père en une envie de voyage soudaine et imprévue. Ils y avaient cru, confiants et certains de son retour. Et moi je vivais dans la honte de mon mensonge, dans la peur de la mort, dans l'anxiété du futur. Qu'allais-je bien pouvoir faire sans mon mari ? Je ne savais pas bien m'occuper des bêtes, et ce n'était pas mes jumeaux de dix ans, Pierre et Jean-Baptiste, qui allaient pouvoir assumer autant de travail quotidiennement. De plus, je m'efforçais d'apprendre à lire, écrire et compter à mes enfants ; ils n'allaient pas à l'école, la plus proche était en ville, à dix-huit kilomètres de la ferme.
Les dettes commençaient à arriver, je ne pouvais plus payer tous mes achats. Chaque semaine, je faisais cinq ou six pains, et deux plaquettes de beurre. Nous ne mangions plus que des pommes de terre, et parfois un morceau de viande quand la bouchère était charitable.
Et la vie suivait son cour, toujours plus dure.
Un soir de Noël 1916, je me souviens avoir reçu une lettre d'Edouard. Il disait aller bien, mais s'être cassé la jambe gauche. Il nous souhaitait un joyeux Noël, et promettait de ramener des cadeaux aux enfants. Tout en bas de la lettre, il m'avait écrit : « Ma Thérèse, prends bien soin de toi. Les officiers envisagent de me laisser revenir quelques jours, au mois de mai. La ferme me manque, les enfants me manquent, tu me manques. Comment vas-tu ? N'oublie pas, ne vends jamais nos vaches, même si l'argent vient à manquer. Je t'embrasse. Ton mari. ». Cette lettre m'avait redonné espoir. Je me voyais déjà accourir dans ses bras, le serrer de toutes mes forces lors de son retour à la maison. J'imaginais déjà une soirée autour du feu, à se raconter des histoires et à chanter de vieilles chansons. Je rêvais de son retour, je ne voulais plus que cela. J'avais tant besoin de lui. Mon pauvre homme. S'il avait su.
Lisa me tend un mouchoir. J'ai pleuré sans m'en rendre compte. Elle déclare que cela suffit, que raconter tout cela me fait trop souffrir. Je tiens tout de même à finir ce que j'ai commencé. J'essuie mes larmes, de ma main tremblante et ridée. Je me lève, traverse le salon, et me rends dans la chambre. J'ouvre le dernier tiroir de ma commode, et saisis une boîte en fer. Elle contient toute ma correspondance avec Edouard, de son départ jusqu'à sa mort. La lettre en haut de la pile est celle d'un officier du régiment m'annonçant la mort de mon mari. Je la prends, et l'amène à Lisa et Antoine. Ils la lisent, les yeux remplis d'émotion. Le silence se fait autour de la table, et le malaise déclenché par la lettre se fait sentir. Lisa range son stylo. Antoine plie ses feuilles. La lettre les a choqués. Ils ont eu les informations qu'ils voulaient, ils ne veulent pas en savoir plus. Ils m'embrassent chacun sur une joue, d'une bise qui claque amèrement. Sans un mot, ils rassemblent leurs affaires et ouvrent la porte de la véranda. Un petit signe de la main, et les voilà là-bas, dans l'allée, rejoignant le petit portail.
Le jour tombe doucement sur le jardin, il est temps pour moi de rentrer. A bientôt mes enfants, à bientôt. Je tire les rideaux, empreinte d'une mélancolie plus forte que celle ressentie durant les années précédentes. Pourquoi faut-il que finisse ma vie seule, sans lui ? Je hais les obus. Je hais les armes. Je hais la violence. Je hais la guerre, plus que les mots ne peuvent le dire. Elle sépare l'époux, l'épouse, le père et ses enfants. Elle ouvre des plaies qui jamais ne se refermeront. Jamais.
Sujet 2
Anne-Lise DUMAS (lamissdu71)
Collège Notre-Dame de Varanges – Givry
Collège Notre-Dame de Varanges – Givry
Deux interprétations du sport
Deux amis, Jacques et Julien, passent leur après-midi à discuter dans le parc voisin.
« - Au fait, Julien, fais-tu encore du sport ?
- Oui, bien-sûr, j'en pratique de plus en plus. J'ai débuté le judo cette année, je fais toujours du tennis deux fois par semaine, de la natation le mercredi et la compétition le dimanche. Pour finir, je pratique la boxe tous les samedis. Et toi d'ailleurs, tu en fais ?
- Pour ma part, je n'ai pas vraiment de temps à consacrer au sport. Malgré cela, chaque samedi, je monte à cheval.
- Je ne pense pas que l'équitation soit un vrai sport, tu sais.
- Et bien, pour moi, le sport n'est pas seulement une façon de développer son corps et ses muscles. C'est surtout un moyen de se divertir, de passer de bons moments avec des personnes ou des animaux, d'apprendre, de s'oxygéner, de penser à autre chose que le travail.
- Je n'ai pas du tout ce point de vue là. Pour ma part, je pense que faire du sport signifie faire travailler son corps, le façonner, le développer en faisant des mouvements ou des exercices physiques.
- Pour revenir à l'équitation, il s'agit bien d'un sport... sinon cette discipline ne serait pas représentée au Jeux Olympiques.
- Oui Jacques, certes. Mais tu vois, quand tu parles d'équitation, tu parles de discipline et non de sport !
- On dit bien aussi que le judo ou le tennis sont des disciplines !
- Oui c'est vrai, mais on dit plus couramment que ce sont des sports. Mais de toute façon, l'équitation n'est pas un sport physique comme le tennis. Tu es tout le temps assis !
- Ha ! Tu n'es pas le premier à me dire ça ! Souvent, on ne voit pas tout le travail qu'effectue un cavalier en selle.
- Tu parles ! Tu devrais essayer de faire du tennis, c'est beaucoup plus physique !
- Tu penseras ce que tu voudras, mais ce n'est pas moi que tu vas faire changer d'avis. L'équitation est une discipline à part car il y a une relation avec un animal, et par ailleurs, il faut un bon équilibre. Pour finir, on est en extérieur. Tout cela est très formateur.
- La natation aussi est très formatrice ! Cela est excellent pour le cœur. Nous apprenons à contrôler notre respiration en plus de façonner notre corps. La natation forme des épaules larges et un dos très musclé.
- Je ne dis pas le contraire, Julien. Mais tout ça n'est pas fait pour moi ! Moi, il me faut quelque chose de relaxant, qui me permette de décompresser.
- Peut-être ! Le judo permet aussi de décompresser, car malgré les prises parfois spectaculaires, il y a des règles très importantes à respecter. D'ailleurs, le respect est le maître-mot du judo.
- En effet, le judo est un bon sport, très formateur pour les jeunes, cela les fait mûrir dans le respect des autres...
- Tu vois, tu accroches ! Et pourtant c'est très physique comme sport et...
- Oui, mais je n'ai jamais dit que cela m'inspirait, moi. Je ne suis plus tout jeune non plus Julien, c'est à prendre en compte ! Je pense sincèrement que tu devrais songer à faire du sport pour t'amuser et te changer les idées au lieu d'être dans la compétition permanente ! Tu vas finir par t'user ! De plus, si jamais tu te fais une blessure grave, cela t'empêchera de travailler : je te rappelle que tu travailles souvent en extérieur et non derrière un bureau. Cela risque de te jouer des tours... Tu ferais bien d'écouter la sagesse des plus anciens que toi. Nous avons de l'expérience !
- Mais non, je me développe ! Toi, par contre, tu devrais penser à développer ton esprit de compétition ! C'est très important, aussi pour le travail !
- Mais ne t'inquiète pas pour moi ! Je suis compétitif lors de concours certains dimanches ! Mais pour moi, le sport est et restera toujours une façon de m'évader, de ne plus penser à rien, d'oublier mes problèmes et mon travail.
- Chacun fait comme il veut, Jacques ! C'est comme tu voudras. Mais un jour tu penseras à moi et tu te diras : « Julien avait raison, j'aurais dû l'écouter et me soucier de l'état physique de mon corps ! ».
- Je ne pense pas que j'aurai de regrets sur ce point là... Mais en revanche, par contre, quand tu te seras gravement blessé, tu penseras à moi et tu te diras :
« J’aurais dû l’écouter. »
- On verra. Bon, allez, rentrons, il se fait tard !
- Oui, tu as raison sur ce point, la nuit commence à tomber ! »
- Oui, bien-sûr, j'en pratique de plus en plus. J'ai débuté le judo cette année, je fais toujours du tennis deux fois par semaine, de la natation le mercredi et la compétition le dimanche. Pour finir, je pratique la boxe tous les samedis. Et toi d'ailleurs, tu en fais ?
- Pour ma part, je n'ai pas vraiment de temps à consacrer au sport. Malgré cela, chaque samedi, je monte à cheval.
- Je ne pense pas que l'équitation soit un vrai sport, tu sais.
- Et bien, pour moi, le sport n'est pas seulement une façon de développer son corps et ses muscles. C'est surtout un moyen de se divertir, de passer de bons moments avec des personnes ou des animaux, d'apprendre, de s'oxygéner, de penser à autre chose que le travail.
- Je n'ai pas du tout ce point de vue là. Pour ma part, je pense que faire du sport signifie faire travailler son corps, le façonner, le développer en faisant des mouvements ou des exercices physiques.
- Pour revenir à l'équitation, il s'agit bien d'un sport... sinon cette discipline ne serait pas représentée au Jeux Olympiques.
- Oui Jacques, certes. Mais tu vois, quand tu parles d'équitation, tu parles de discipline et non de sport !
- On dit bien aussi que le judo ou le tennis sont des disciplines !
- Oui c'est vrai, mais on dit plus couramment que ce sont des sports. Mais de toute façon, l'équitation n'est pas un sport physique comme le tennis. Tu es tout le temps assis !
- Ha ! Tu n'es pas le premier à me dire ça ! Souvent, on ne voit pas tout le travail qu'effectue un cavalier en selle.
- Tu parles ! Tu devrais essayer de faire du tennis, c'est beaucoup plus physique !
- Tu penseras ce que tu voudras, mais ce n'est pas moi que tu vas faire changer d'avis. L'équitation est une discipline à part car il y a une relation avec un animal, et par ailleurs, il faut un bon équilibre. Pour finir, on est en extérieur. Tout cela est très formateur.
- La natation aussi est très formatrice ! Cela est excellent pour le cœur. Nous apprenons à contrôler notre respiration en plus de façonner notre corps. La natation forme des épaules larges et un dos très musclé.
- Je ne dis pas le contraire, Julien. Mais tout ça n'est pas fait pour moi ! Moi, il me faut quelque chose de relaxant, qui me permette de décompresser.
- Peut-être ! Le judo permet aussi de décompresser, car malgré les prises parfois spectaculaires, il y a des règles très importantes à respecter. D'ailleurs, le respect est le maître-mot du judo.
- En effet, le judo est un bon sport, très formateur pour les jeunes, cela les fait mûrir dans le respect des autres...
- Tu vois, tu accroches ! Et pourtant c'est très physique comme sport et...
- Oui, mais je n'ai jamais dit que cela m'inspirait, moi. Je ne suis plus tout jeune non plus Julien, c'est à prendre en compte ! Je pense sincèrement que tu devrais songer à faire du sport pour t'amuser et te changer les idées au lieu d'être dans la compétition permanente ! Tu vas finir par t'user ! De plus, si jamais tu te fais une blessure grave, cela t'empêchera de travailler : je te rappelle que tu travailles souvent en extérieur et non derrière un bureau. Cela risque de te jouer des tours... Tu ferais bien d'écouter la sagesse des plus anciens que toi. Nous avons de l'expérience !
- Mais non, je me développe ! Toi, par contre, tu devrais penser à développer ton esprit de compétition ! C'est très important, aussi pour le travail !
- Mais ne t'inquiète pas pour moi ! Je suis compétitif lors de concours certains dimanches ! Mais pour moi, le sport est et restera toujours une façon de m'évader, de ne plus penser à rien, d'oublier mes problèmes et mon travail.
- Chacun fait comme il veut, Jacques ! C'est comme tu voudras. Mais un jour tu penseras à moi et tu te diras : « Julien avait raison, j'aurais dû l'écouter et me soucier de l'état physique de mon corps ! ».
- Je ne pense pas que j'aurai de regrets sur ce point là... Mais en revanche, par contre, quand tu te seras gravement blessé, tu penseras à moi et tu te diras :
« J’aurais dû l’écouter. »
- On verra. Bon, allez, rentrons, il se fait tard !
- Oui, tu as raison sur ce point, la nuit commence à tomber ! »
Les deux amis arrivent devant la porte de Jacques.
« - Bon, allez Jacques, avoue que j'ai raison ! Le sport, c'est fait pour se muscler.
- Non, pour s'évader, penser à autre chose !
- Se développer !
- S'amuser !
- Façonner son corps !
- Oublier ses soucis !
- Bon, je pense qu'on ne tombera jamais d'accord si on continue comme ça Jacques ! Allez, mets-toi d'accord avec moi, et comme ça, nous en aurons fini sur ce point !
- Ah non! Cela ne marche pas comme ça avec moi ! Je ne changerai pas d'avis. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas le même avis sur le sport qu'il faut nous fâcher !
- Bon !! Alors, ne nous fâchons pas !
- Dans tous les cas, fais très attention aux blessures ! La boxe est un sport dangereux ! Enfin, tu le sais bien ; je ne dois pas être le premier à te le dire !
- Peut-être, mais cela me permet de me défouler aussi.
- En tout cas, ce sport non plus n'est pas fait pour moi ! Taper sur les autres et se faire taper ne m'inspire pas du tout !
- La boxe ne se résume pas qu'à cela. Encore une fois, nous apprenons à respecter des règles et à nous contrôler.
- Enfin, je ne serai jamais comme toi Julien, tu le sais bien ! Chacun a un sport qui lui convient !
- Oui, tu as raison ! Allez, j’y vais ! Content d'avoir échangé avec toi tout !
- Oui, moi aussi Julien, à la prochaine, sportif ! Tâche de me ramener une médaille pour la prochaine fois !!
- Tu ne penses pas si bien dire, Jacques ! J'en ai une boîte pleine ! Je t'en amènerai la prochaine fois !
- Quel champion tu es !! Je parie que tu as déjà toute la collection !
- Oui, à peu près, mais il me manque celle des Jeux Olympiques !!!
- Haha !! Tu m'appelleras quand tu y seras !
- Ok, ça marche !! Mais je ne risque pas de t'appeler de si tôt !
- Oui, c'est sûr ! Le niveau est très élevé ! Bon allez, je vais préparer mon dîner ! Bonne soirée à toi !
- Oui, à toi aussi ! A bientôt, cavalier !
- A bientôt, sportif ! »
- Non, pour s'évader, penser à autre chose !
- Se développer !
- S'amuser !
- Façonner son corps !
- Oublier ses soucis !
- Bon, je pense qu'on ne tombera jamais d'accord si on continue comme ça Jacques ! Allez, mets-toi d'accord avec moi, et comme ça, nous en aurons fini sur ce point !
- Ah non! Cela ne marche pas comme ça avec moi ! Je ne changerai pas d'avis. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas le même avis sur le sport qu'il faut nous fâcher !
- Bon !! Alors, ne nous fâchons pas !
- Dans tous les cas, fais très attention aux blessures ! La boxe est un sport dangereux ! Enfin, tu le sais bien ; je ne dois pas être le premier à te le dire !
- Peut-être, mais cela me permet de me défouler aussi.
- En tout cas, ce sport non plus n'est pas fait pour moi ! Taper sur les autres et se faire taper ne m'inspire pas du tout !
- La boxe ne se résume pas qu'à cela. Encore une fois, nous apprenons à respecter des règles et à nous contrôler.
- Enfin, je ne serai jamais comme toi Julien, tu le sais bien ! Chacun a un sport qui lui convient !
- Oui, tu as raison ! Allez, j’y vais ! Content d'avoir échangé avec toi tout !
- Oui, moi aussi Julien, à la prochaine, sportif ! Tâche de me ramener une médaille pour la prochaine fois !!
- Tu ne penses pas si bien dire, Jacques ! J'en ai une boîte pleine ! Je t'en amènerai la prochaine fois !
- Quel champion tu es !! Je parie que tu as déjà toute la collection !
- Oui, à peu près, mais il me manque celle des Jeux Olympiques !!!
- Haha !! Tu m'appelleras quand tu y seras !
- Ok, ça marche !! Mais je ne risque pas de t'appeler de si tôt !
- Oui, c'est sûr ! Le niveau est très élevé ! Bon allez, je vais préparer mon dîner ! Bonne soirée à toi !
- Oui, à toi aussi ! A bientôt, cavalier !
- A bientôt, sportif ! »
Niveau Lycée
Sujet 1
1er prix : Elisabeth SOLA (Licheur)
Lycée du Castel – Dijon
Lycée du Castel – Dijon
Un cerf... titude
Un vent glacial entrait par la petite fenêtre aux carreaux brisés de la maison. Cette masure que nous louions tombait en ruine. Le vent s'engouffrant par le moindre trou, le toit fuyant et l'absence de cheminée faisaient de ce foyer un endroit détestable.
Je me réveillai, tirée du sommeil par des bruits plutôt inhabituels à cette heure-ci. Je me redressai et sortis de la minuscule pièce qui me tenait lieu de chambre pour retrouver Père dehors, ainsi que Mère et Jacques, mon petit frère de trois ans. Ils s'affairaient autour de la carriole que nous possédions et mon père entreprit d'y attacher Noisette, notre jument. Etonnée, je m’approchai d’eux.
« Ah Blanche, tu es enfin réveillée ! s'exclama Père. Tiens, viens nous aider. Nous allons à la foire de Lagny-sur Marne.
- Et nous partons déjà ?
- Oui, répondit Père. Il nous faudra bien deux mois pour nous y rendre, en comptant deux ou trois arrêts dans les grandes villes que nous traverserons. Va te préparer, nous partons dès que tout sera fini. »
Nous étions en effet des marchands itinérants, sans cesse en déplacement en fonction des différentes foires et grands marchés. Nous revendions surtout des objets de petite valeur, des vêtements que nous tissions, des poteries parfois, ou encore des sculptures sur bois, la spécialité de Père.
Je n'étais pas mécontente de quitter Chamalières, ce petit village du Massif Central près de ClermontFerrand. La routine ne convenait pas à mon tempérament vif, ce que j'aimais c'était l'aventure ! J'adorais parcourir les chemins en tous sens, et j'avais un très bon sens de l'orientation.
Je filai dans ma chambre me changer et passer des habits de voyage. L'avantage de se retrouver en pleine nature était de pouvoir me vêtir comme je l'entendais. J'enfilai mon pantalon de toile, une vieille chemise et me nouai les cheveux en arrière. Je terminai par une cape dont je rabattis la capuche. Quel bonheur de ne plus être obligée de porter ma jupe en laine et mon corset ! J’aimais m'habiller comme un garçon, ce que je ne pouvais pas faire en ville. Bien évidemment, mes parents n'étaient pas vraiment d'accord avec moi. Ils s'effrayaient de mon goût pour les habits masculins et répétaient à longueur de journée qu'une jeune femme de quinze ans se devait de porter des jupes et des robes, et de chercher un futur époux plutôt que de perdre son temps à s'entraîner au combat. Mais j'étais très têtue...
Je redescendis aider mes parents à préparer le chariot et emporter les marchandises que nous devions vendre. Vers midi, tout était prêt. C'est ainsi qu'en ce jour de la Saint-Clément de l'an de grâce 1452 nous partîmes pour Lagny-sur-Marne.
Au bout d'un mois de voyage sans incident, nous nous approchions du Morvan. Nous fîmes halte dans un petit village nommé Decize, situé à la lisière de la forêt et comptant tout au plus 75 âmes. Père avait décidé de faire une brève pause, afin de laisser Noisette se reposer et de faire quelques achats auprès des villageois. Je l'accompagnai, tandis que Mère s'occupait de Jacques. Etonnamment les petites rues étaient désertes, et lorsque nous frappâmes à la porte de la première maison, personne ne nous répondit. Même constat pour la plupart des maisons. Et pourtant, les portes fermées s'ouvraient furtivement dans notre dos, pour claquer aussi vite. Les rares visages entrevus semblaient horrifiés.
« Qu'avons-nous donc fait pour être traités ainsi ? m’écriai-je tandis que la colère montait en moi. Les villageois sont-ils donc si sauvages ici qu'ils refusent de parler avec de pauvres marchands qui n'ont point eu de compagnie depuis un mois ? »
Personne ne me répondit. Seul un chat famélique passa en courant devant nous. Dépitée, je m'apprêtais à partir lorsqu'une jeune fille sortit la tête de sa maison.
« Ne vous emportez pas, messires, (elle m'avait prise pour un garçon). Ce n'est point contre vous, mais vous devez savoir que...
La jeune fille hésita, une grimace terrifiée plissa son visage.
- Oui ? l'encouragea Père.
- C’est qu’il se passe de drôles de choses en ce moment dans la forêt. Des choses inexplicables. Nous vivons dans la peur et le doute, et tous les étrangers sont sources de méfiance.
- Allons donc, répondis-je d'une voix grave. Nous nous en allons par la forêt, et je puis vous assurer que nous n'y trouverons rien d'inhabituel !
- Oh, non, messires ! supplia-t-elle. Ne faites pas ça, je vous en prie ! Tant d'autres ont disparu sans laisser de traces ! On raconte que c'est le fantôme d'un jeune noble assassiné qui revient se venger en emportant les âmes des malheureux voyageurs qui passent dans cette forêt. On dit qu'il se présente sous la forme d'un cerf...
- Calmez-vous, répliquai-je. Nous avons déjà rencontré des bandits et des gens d'armes sur notre route, ce n’est pas un fantôme qui va nous faire reculer ! Sur ce, bonne journée ! »
La fille se tordit les mains d'angoisse, et nous lança un dernier regard suppliant. Finalement, elle céda et nous souffla dans un murmure de prendre garde. Nous nous remîmes en route l'heure d'après. Ce n'étaient pas de folles histoires de bonnes femmes et de paysans terrorisés qui allaient nous arrêter. C'est ainsi que nous nous engageâmes sur un petit chemin boueux qui serpentait à travers la forêt de pins et de chênes.
Dès que nous eûmes pénétré dans la sombre forêt, l'air se rafraichit. Un vent glacial se leva subitement, me faisant frissonner. Nous cheminâmes ainsi quelques heures jusqu'au coucher du soleil. Père décida de faire halte dans une petite clairière où coulait un ruisseau. Je défis Noisette et entreprit de préparer le souper en compagnie de Mère, tandis que Père allait chercher un peu de bois pour entretenir le feu. Nous dînâmes de viande de cochon séchée, agrémentée de quelques baies et racines. Puis, tombant de fatigue, je m'enroulai en boule contre une souche d'arbre et m'endormis.
Je me réveillai en sursaut. Un bruit, un craquement de branche venait de me tirer du sommeil. Ma main glissa instinctivement vers le fourreau de ma dague et j'en serrai le manche, prête à m'en servir. Je me redressai lentement, tandis que mes yeux, qui s'adaptaient progressivement à l'obscurité, parcouraient minutieusement la clairière. Le feu éteint, je ne distinguais rien au milieu des ténèbres, sinon des ombres mouvantes qui me firent frissonner. J'allais me recoucher lorsque le même son retentit, une fois encore. Maintenant parfaitement réveillée, je me coulai doucement vers Père et l'avertis du danger potentiel. Il prit la relève, me conseillant de dormir encore quelques heures. Je me couchai, mais restais dans un état second. Il me sembla plusieurs fois apercevoir deux points rouges entre les arbres, mais c'était sûrement mon esprit embrumé qui me jouait des tours.
Le lendemain, je me levai en ayant mal à la tête. Malgré ces quelques heures de sommeil, j'étais déjà fatiguée et je n'avais pas l'impression de m'être reposée. Père me dit qu'il n'avait rien vu ni entendu d'étrange, si ce n'étaient les multiples bruits de la forêt et des animaux.
Nous repartîmes aux environs de huit heures du matin. A travers l'épaisse voûte des arbres, je pouvais distinguer un ciel gris et très nuageux. La pluie allait probablement arriver dans l'après-midi. Noisette semblait de plus en plus nerveuse à mesure que nous progressions vers le cœur de la forêt. Elle refusa plusieurs fois d'avancer, et nous dûmes la tirer de force. Peut-être avait-t-elle senti la présence de prédateurs...
Nous n'avions plus de viande pour le repas de midi, je décidai alors d'aller chasser un peu. Je m'éloignai du sentier et m'enfonçai dans les fourrés. La température chuta brusquement, et je resserrai les pans de ma cape. Quelque chose me perturbait, mais je n'arrivai pas à savoir quoi. Ma dague à la main, j'écoutai, à l'affût du moindre bruit.
Soudain, je compris ce qui n'allait pas. La forêt était calme, beaucoup trop calme. Les oiseaux s'étaient tus, aucune branche ne craquait. Le silence était pesant, anormal. Je continuai d'avancer et débouchai dans un taillis. Au centre, j'aperçus un lapin. Mort. Et intact. Ma méfiance augmenta, tout comme mon mauvais pressentiment. Si un animal l'avait tué, il aurait dû ne rester qu'une carcasse. Si c'était un homme, il aurait dû y avoir une trace de blessure ou de piège. Mais là, rien.
Je m'approchai prudemment et saisis l'animal mort par les oreilles. C'est alors qu'un vent soudain balaya les feuilles mortes, mugissant autour de moi. Le ciel devint d'un noir d'encre, ne laissant voir que des ombres. Baissant les yeux vers ma main, je poussai un hurlement d'effroi et lâchai le lapin. Une grosse marque noirâtre s'était formée sur ma peau et remontait à une vitesse folle vers mon bras, tel du poison mortel. La marque disparut dès que j'eus lâché l'animal. Le vent se calma, le ciel se découvrit. Encore tremblante, je serrai ma main. Etait-ce une illusion ? Oui, c’était forcément ça, il n’y avait pas d’autre explication. Je revins en courant sur mes pas, le cœur tambourinant dans ma poitrine, et rejoignis le chariot, faisant de mon mieux pour masquer mon trouble.
Nous poursuivîmes notre route tout l'après-midi. J'avais de plus en plus froid, et une pluie violente se mit à tomber, transformant le sentier en un horrible chemin boueux. Noisette peinait à avancer car les roues du chariot s'embourbaient tous les cinq pas. Je dus aider Père à pousser la carriole pendant près de trois heures. J'avais horriblement mal à la tête et mes muscles étaient tétanisés. Je luttai pour avancer, chaque pas me coûtait un terrible effort. Lorsque nous nous arrêtâmes le soir pour souper et dormir, j'étais exténuée. Mes vêtements couverts de boue froide et de pluie me collaient à la peau, me donnant de violents frissons. J'étais glacée, mais pas seulement à cause du temps. J'avais un mauvais pressentiment.
J'avais toujours aussi froid, et je me rendis compte que j'avais de la fièvre. Le paysage me donnait l'impression de tournoyer et je me recroquevillai dans le chariot. A l'avant, Noisette semblait nerveuse et tirait sur les rênes, comme si elle sentait la présence d'un loup. Je n'avais pas faim, seulement sommeil. Je fermai les yeux pour me soustraire au décor tourbillonnant et sombrai dans un sommeil profond sans même m'en rendre compte.
Ce fut un hennissement de terreur qui me réveilla. Ma fièvre n'était pas tombée, je souffrais toujours autant. Je me relevai juste à temps pour voir Noisette, les yeux agrandis par la peur, se libérer de la corde qui l'attachait à un arbre pour se précipiter dans la forêt. Je l'appelai à grands cris mais elle ne revint pas. Père et Mère gisaient au sol, comme morts. Je dus passer par-dessus les sacs de marchandises pour descendre du chariot et tenter en vain de les réveiller. Aucun signe de Jacques non plus. Soudain, je l'entendis. Le même craquement étrange que l'autre nuit. Il n'y avait plus aucun bruit dans la forêt. Un nuage noir voila le faible rayon de lune qui arrivait encore à percer à travers les arbres. Lentement, je me retournais. Et il était là.
Un cerf immense se tenait à quelques mètres de moi, me faisant face. L'un de ses bois était cassé, l'autre tordu. Il lui manquait une patte, et du pus jaunâtre s'écoulait d'une plaie qu'il avait au flanc. De la salive noire dégoulinait de son museau putréfié. Une écœurante odeur de décomposition s'élevait de l'animal. Mais le pire étaient ses yeux. Des yeux rougeoyants et brûlants comme l'enfer. Des yeux de démon. Les yeux du Diable.
Je voulus m'enfuir mais une force surnaturelle me clouait sur place. J'étais paralysée, mes muscles ne me répondaient plus. Il s'avança vers moi, et je crus défaillir de peur. Je sentais son haleine nauséabonde sur mon visage. Ses yeux rivés aux miens, je crus voir passer une lueur de satisfaction, de folie et de cruauté mêlées. Il était près, si près... Soudain, alors que je sentais le bout de ses poils sur ma peau et que je croyais ma dernière heure arrivée, un hennissement furieux retentit. C'était Noisette qui revenait ! L'enchantement se rompit alors. Le cerf me lança un dernier regard brûlant de haine et de colère et s'enfuit dans la forêt. A bout de force, je tombai et me cognai violemment la tête contre le sol. Je glissai instantanément dans l'inconscience...
Lorsque j’ouvris les yeux, mon regard embué se posé sur Mère qui me fixait d'un œil inquiet. « Ah, enfin Blanche, tu es réveillée ! s'exclama-t-elle soulagée. Tu nous as fait peur !
- Le cerf ! hurlai-je alors que tout me revenait.
-Quel cerf ? s'enquit Mère. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es tombée du chariot alors que tu dormais et tu t'es ouvert le crâne.
Effectivement, je saignais. La blessure correspondait à celle que je m'étais faite ou croyais m'être faite la veille. J'insistai, mais devant l'expression de Mère, je compris qu'il ne servait à rien d'argumenter, elle ne me croirait pas. D'ailleurs j'avais du mal à y croire moi aussi. C'était sûrement la fièvre qui m'avait fait délirer... C'est alors que je repensai à l'absence de mon frère.
- Et Jacques, repris-je affolée, il n'était pas là cette nuit !
- Mais si, contesta Mère en fronçant les sourcils. Il dormait entre ton père et moi. Il est là, regarde.
Je levai difficilement la tête et aperçut mon petit frère qui me faisait un signe de la main, un sourire aux lèvres.
- Allez, repose-toi, conclut Mère. Le choc t'a complètement perturbée...
Vaincue, je retombai sur le sol. J'étais exténuée, vidée de toute force. Je n'avais qu'une envie : plonger dans un sommeil sans rêve et tout oublier. Alors que j'allais m'endormir, j'aperçus mon frère entre mes paupières mi closes. Avant de se retourner, il me fixa brièvement.
Avec des yeux rougeoyants ...
-MERE!!! hurlai-je » ...
2e prix : Svetoslava RODIONOVA (PetitOurs26)
Lycée Julien Wittmer – Charolles
Lycée Julien Wittmer – Charolles
Cauchemar sucré
J'étais là, dans ma chambre, à regarder une émission de cuisine à la télévision, que j'ai eu une soudaine envie de manger du chocolat. Ma bouche devenait pâteuse, et j'avais l'impression que c'était le seul goût qui manquait à mes papilles. Je descendis donc à la cuisine en proie de cet aliment sucré, je me servis dans le placard et en me retournant je fus surprise de voir ma mère, juste derrière moi, dans le noir, qui découpait une pomme directement dans ses mains. Elle me demanda un carré de chocolat, et comme la pomme qu'elle avait mangée était apparemment très juteuse, quelques gouttes de ce jus tombèrent par terre pendant qu'elle tendait sa main.
J'étais là, dans ma chambre, à regarder la télévision, que j'ai eu une soudaine envie de manger du chocolat. Ma bouche salivait, et j'avais l'impression que c'était le seul goût qui éveillerait mes papilles. Je descendis donc à la cuisine en proie de cette douceur, je me servis dans le placard et en me retournant je fus surprise de voir ma mère, juste derrière moi, dans le noir, qui coupait une pomme dans ses mains. Elle me demanda un carré, tendit sa main vers moi, et bizarrement j'ai eu le réflexe de baisser la tête, il y avait par terre quelques gouttes de sang.
J'étais là, dans ma chambre, je dormais paisiblement et je faisais un rêve, soudain, j'ai vraiment eu envie de manger du chocolat. Cette envie devenait incontrôlable, alors je me suis levée. Je descendis donc à la cuisine en proie de cet aliment sucré, je me servis dans le placard et en me retournant je tombai nez à nez avec ma mère, juste derrière moi, dans le noir, qui coupait un fruit. Elle m'en demanda un bout, le prit, et moi, en regardant par terre je vis du sang, et j'entendis un bruit étrange, une sorte de soupir, un faible cri de douleur.
J'étais là, dans ma chambre, à faire un rêve où je cuisinais, et j'ai eu une énorme envie de manger du chocolat. Je n'arrivais pas à me contrôler, j'étais dans un état de folie, alors je me levai un peu malgré moi. Je descendis à la cuisine pour combler ce manque, je me servis et je tombai nez à nez avec ma mère, dans le noir, en train de manger elle aussi. Elle me demanda un morceau, tendit sa main vers moi, en regardant par terre je vis du sang, et j'entendis un bruit étrange, une sorte de soupir, un cri de douleur. Affolée, je regardai alors ma mère, puis son couteau, et j'ai alors compris que les gouttes de sang en tombaient.
J'étais là, dans ma chambre, à rêver de nourriture, et j'ai soudainement eu une irrésistible envie de chocolat. Ma bouche devenait pâteuse, je salivais, je n'arrivais plus à me contrôler, une force me poussa hors de mon lit. Je descendis les escaliers à toute allure, je me servis dans le placard et en me retournant j'ai vu ma mère avec un couteau et quelque chose d'autre dans les mains. Elle me demanda du chocolat, le prit, et moi, en regardant par terre je vis du sang, et j'entendis un bruit étrange, un cri de douleur intrigant. Apeurée, je regardai alors ma mère, puis son couteau, et j'ai alors compris que les gouttes de sang en tombaient. Par instinct, je reculai, et en me retournant vers les escaliers je vis mon père y gisant ivre mort, la chemise défaite et une bouteille à la main.
J'étais là, dans ma chambre, à rêver de chocolat, et sûrement à cause de ça, ma bouche s'est mise à saliver, et mes papilles réclamaient cette douceur. Je me retrouvai à la cuisine en quelques secondes, et juste derrière moi je sentis le parfum de ma mère, ainsi que celui d'une pomme, je me retournai et je vis qu'elle tenait un couteau dans les mains. Elle me demanda un morceau, le prit, je regardai par terre je vis du sang. Ensuite, j'entendis un bruit étrange, un cri perçant de douleur. Tétanisée par la peur, je regardai ma mère, son couteau, et les gouttes de sang qui en tombaient. Je reculai, et en me retournant vers les escaliers je vis mon père y gisant, visiblement revenu d'un bar. Quand je me tournais de nouveau vers ma mère elle me dit le plus calmement du monde
« J'en avais marre de le voir saoul ...
Voilà la fin de ce cauchemar. »
J'étais là, dans ma chambre, à regarder la télévision, que j'ai eu une soudaine envie de manger du chocolat. Ma bouche salivait, et j'avais l'impression que c'était le seul goût qui éveillerait mes papilles. Je descendis donc à la cuisine en proie de cette douceur, je me servis dans le placard et en me retournant je fus surprise de voir ma mère, juste derrière moi, dans le noir, qui coupait une pomme dans ses mains. Elle me demanda un carré, tendit sa main vers moi, et bizarrement j'ai eu le réflexe de baisser la tête, il y avait par terre quelques gouttes de sang.
J'étais là, dans ma chambre, je dormais paisiblement et je faisais un rêve, soudain, j'ai vraiment eu envie de manger du chocolat. Cette envie devenait incontrôlable, alors je me suis levée. Je descendis donc à la cuisine en proie de cet aliment sucré, je me servis dans le placard et en me retournant je tombai nez à nez avec ma mère, juste derrière moi, dans le noir, qui coupait un fruit. Elle m'en demanda un bout, le prit, et moi, en regardant par terre je vis du sang, et j'entendis un bruit étrange, une sorte de soupir, un faible cri de douleur.
J'étais là, dans ma chambre, à faire un rêve où je cuisinais, et j'ai eu une énorme envie de manger du chocolat. Je n'arrivais pas à me contrôler, j'étais dans un état de folie, alors je me levai un peu malgré moi. Je descendis à la cuisine pour combler ce manque, je me servis et je tombai nez à nez avec ma mère, dans le noir, en train de manger elle aussi. Elle me demanda un morceau, tendit sa main vers moi, en regardant par terre je vis du sang, et j'entendis un bruit étrange, une sorte de soupir, un cri de douleur. Affolée, je regardai alors ma mère, puis son couteau, et j'ai alors compris que les gouttes de sang en tombaient.
J'étais là, dans ma chambre, à rêver de nourriture, et j'ai soudainement eu une irrésistible envie de chocolat. Ma bouche devenait pâteuse, je salivais, je n'arrivais plus à me contrôler, une force me poussa hors de mon lit. Je descendis les escaliers à toute allure, je me servis dans le placard et en me retournant j'ai vu ma mère avec un couteau et quelque chose d'autre dans les mains. Elle me demanda du chocolat, le prit, et moi, en regardant par terre je vis du sang, et j'entendis un bruit étrange, un cri de douleur intrigant. Apeurée, je regardai alors ma mère, puis son couteau, et j'ai alors compris que les gouttes de sang en tombaient. Par instinct, je reculai, et en me retournant vers les escaliers je vis mon père y gisant ivre mort, la chemise défaite et une bouteille à la main.
J'étais là, dans ma chambre, à rêver de chocolat, et sûrement à cause de ça, ma bouche s'est mise à saliver, et mes papilles réclamaient cette douceur. Je me retrouvai à la cuisine en quelques secondes, et juste derrière moi je sentis le parfum de ma mère, ainsi que celui d'une pomme, je me retournai et je vis qu'elle tenait un couteau dans les mains. Elle me demanda un morceau, le prit, je regardai par terre je vis du sang. Ensuite, j'entendis un bruit étrange, un cri perçant de douleur. Tétanisée par la peur, je regardai ma mère, son couteau, et les gouttes de sang qui en tombaient. Je reculai, et en me retournant vers les escaliers je vis mon père y gisant, visiblement revenu d'un bar. Quand je me tournais de nouveau vers ma mère elle me dit le plus calmement du monde
« J'en avais marre de le voir saoul ...
Voilà la fin de ce cauchemar. »
Sujet 2
1er prix : Léa GRIFFOULIERE (Ayakarimono)
Lycée Bonaparte – Autun
Lycée Bonaparte – Autun
Yggdrasil
C'est un vieil arbre immense
Des branches dans tous les sens
Comme autant de sentiers
Tous autant arpentés
Tous venant des racines
Nous grimpons à la cime
Tous nous avançons
Dans la même direction
Sans jamais nous croiser
Jamais nous regarder
Ensemble séparé
Solitude unifiée
Une boucle se répète
Dès que la branche s'arrête
C'est le même chemin
C'est le même destin
Regardons droit devant
Perdus dans le néant
Nous marchons,
nous marchons
Regardant l'horizon
J'aimerais reculer
Qu'on cesse d'avancer
Sur ce si long sentier
Je voudrais m'arrêter
Je voudrais tant crier
Ne plus rien regarder
Ne plus voir le chemin
Et ne plus voir sa fin
Pouvoir tout oublier
Pouvoir y échapper
Briser le sablier
Et cesser de compter
Mais,
Continuant d'avancer
Chacun de son coté
Ne pas lever les yeux
Ne pas voir le ciel bleu
Sans poser de questions
Tous nous avançons
Sans regarder derrière
En gardant nos œillères
Sans jamais s'arrêter
Sans jamais reculer
Sans jamais se croiser
Sans cesser d'avancer
Nombres sentiers l'on prend
Car le monde est devant.
2e prix : Aimée GOUSSOT (Macska Guanahani)
Lycée international Charles de Gaulle - Dijon
Lycée international Charles de Gaulle - Dijon
Le bandit de grands chemins
Les chemins sont mon ombre
Je suis l'ombre des chemins
Le soir, quand la nuit tombe,
Ils me prient, mais en vain,
D'épargner leurs cœurs et leurs âmes
Ils ne savent pas qui je suis
Mais, à la lueur de la flamme,
Dans leurs yeux la peur se lit.
Je suis l'ombre des chemins
Le soir, quand la nuit tombe,
Ils me prient, mais en vain,
D'épargner leurs cœurs et leurs âmes
Ils ne savent pas qui je suis
Mais, à la lueur de la flamme,
Dans leurs yeux la peur se lit.
Peut-être pensent-ils que je vais les tuer
Les voler ou les traîner en enfer
Aucun ne peut deviner la vérité
Aucun ne peut me satisfaire
Oui, j'ai été mauvais, je sais
Mais je me suis repenti pour Elle
Elle était ma guerre et ma paix
Et, depuis qu'Elle est partie à tire-d'aile,
Les chemins sont mon ombre
Je suis l'ombre des chemins.
Les voler ou les traîner en enfer
Aucun ne peut deviner la vérité
Aucun ne peut me satisfaire
Oui, j'ai été mauvais, je sais
Mais je me suis repenti pour Elle
Elle était ma guerre et ma paix
Et, depuis qu'Elle est partie à tire-d'aile,
Les chemins sont mon ombre
Je suis l'ombre des chemins.
J'ai parcouru tant de pays
Je l'ai appelée tant de fois
Comme Elle, je suis parti
Comme Elle, je n'ai plus de loi.
L'espoir a quitté mon corps
Mais je ne peux quitter la route
Au fond, je crois que je suis mort
Non, je n'ai plus de doutes
Je l'ai appelée tant de fois
Comme Elle, je suis parti
Comme Elle, je n'ai plus de loi.
L'espoir a quitté mon corps
Mais je ne peux quitter la route
Au fond, je crois que je suis mort
Non, je n'ai plus de doutes
Je ne peux plus qu'avancer
Tel un aveugle, tel un mendiant
Elle me fait mal plus qu'Elle ne m'a aimé
Mais je mourrai en la cherchant
Tel un aveugle, tel un mendiant
Elle me fait mal plus qu'Elle ne m'a aimé
Mais je mourrai en la cherchant
Les chemins sont mon asile et ma prison
La solitude est ma folie et ma peine
Je finirai bien par perdre la raison
Je sais que les chemins m'y mènent
Car j'ai choisi Son souvenir sombre
Et, le soir plus que jamais, lorsqu'on me craint
Les chemins sont mon ombre
Je suis l'ombre des chemins.
La solitude est ma folie et ma peine
Je finirai bien par perdre la raison
Je sais que les chemins m'y mènent
Car j'ai choisi Son souvenir sombre
Et, le soir plus que jamais, lorsqu'on me craint
Les chemins sont mon ombre
Je suis l'ombre des chemins.