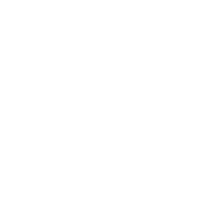Un soir, un livre 2019
Ci-dessous : les comptes-rendus rédigés par Jeanne Bem
|
|
Mercredi 11 décembre 2019 : Jean-Paul Dubois, "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon"

Nous étions dix-sept hier chez Elisabeth - une affluence record. Merci pour son accueil!
La discussion portait sur le dernier Goncourt: Jean-Paul Dubois, "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon", Editions de l'Olivier.
Le roman a été unanimement bien reçu. Certain(e)s l'ont trouvé de très bonne qualité. La discussion a été animée et on a apporté des nuances.
Le roman se déroule simultanément et de façon alternée sur deux lieux: la cellule de prison et ... le monde - lieux proches ou lointains, strates temporelles successives. Beaucoup de personnages, beaucoup d'amorces d'histoires, mais le Narrateur, Paul, suit en gros dans ses souvenirs la chronologie de sa vie. Donc c'est assez linéaire et d'une lecture facile. Le romancier utilise certainement ses nombreuses expériences pour les "caser" au fur et à mesure.
Il y a de la gaîté dans le style, de l'humour (un peu noir) - par exemple en ce qui concerne les péripéties du père pasteur. Parfois le ton est grave: pour évoquer Winona - une belle figure féminine, ou même la chienne Nouk. Ou à la fin, avec ce retour à Skagen, "chez les miens". Le personnage le plus fouillé, humain et drôle est Patrick, le co-détenu. Une mention spéciale pour la maman de Paul et son cinéma débridé.
L'immeuble dont s'est occupé Paul est un personnage en soi. Quand est dévoilée la seule vraie énigme (pourquoi Paul a été condamné à deux ans de prison), le lecteur est soulagé et partage l'approbation exprimée par Patrick dès le début du livre: "ces mecs-là, il faut les ouvrir en deux!" On pourrait parler du réalisme poétique de Jean-Paul Dubois: l'exactitude des lieux et des descriptions (par exemple Montréal qu'il connaît bien) est comme un peu déformée, métamorphosée par des détails, des points de vue. Les grands espaces canadiens sont plus beaux, vus de l'hydravion. Le romancier a éliminé un élément du réel linguistique: le québécois. Patrick parle un argot qui semble sorti de "Touchez pas au grisbi". Pourquoi le Goncourt a-t-il couronné ce roman: probablement à cause de la longue carrière du romancier, et parce que le message est humaniste, ce dont nous avons grand besoin par les temps qui courent.
Lundi 4 novembre 2019 : Fawzia Zouari, "Le corps de ma mère"

Nous étions onze hier soir chez Nicole N. - merci à elle pour son accueil. Trois personnes s'étaient excusées mais avaient envoyé leur avis.
Très bonne discussion autour du livre de Fawzia Zouari, "Le corps de ma mère". La page de titre ne précise pas s'il s'agit d'un roman. On suppose qu'il y a une grande part de vécu personnel dans ce livre, mais sa composition en trois parties, son style souvent très inventif et - dans la deuxième partie - la dimension ample, lyrique, mythologique de certains moments ou personnages, tout cela nous renvoie à une ambition littéraire et une forme de fiction.
Sur la première partie, les avis étaient partagés: son utilité a été questionnée, alors qu'au contraire on était plusieurs à la valoriser. La première partie, la mère à l'hôpital à Tunis entourée des siens, parle au lecteur / à la lectrice occidentale, c'est ce qui se rapproche le plus de notre propre expérience. Les relations, les noms des protagonistes, les embryons de récits se mettent en place: ils seront complétés et élucidés dans la deuxième partie. Donc la première partie est structurellement et poétiquement nécessaire. Elle constitue aussi un texte à part, fermé, elle pourrait faire une nouvelle - en la terminant nous resterions sur notre faim, les énigmes ne seraient pas résolues, ce serait alors un texte "moderne".
La tradition joue un grand rôle dans ce roman. Sur le plan formel: la transmission à la fille du récit de vie de la mère à travers la servante qui l'a recueilli est un poncif du roman à l'ancienne et du conte. Il entre pas mal des "Mille et une nuits" dans "Le corps de ma mère". Tradition bien sûr aussi dans la thématique: le fond historique, assez flou, est une centaine d'années de l'histoire de la Tunisie. La société et les façons de vivre sont très "orientales" (même si des coutumes semblables ont existé en Europe jusque dans les années 1950, à la campagne). Une participante nous a fait un récit très coloré de deux mariages traditionnels auxquels elle a assisté dans le Sud algérien. Fawzia Zouari ne tait rien de la condition subalterne des femmes dans cet Orient, de leur enfermement, de leur souffrances, de leur dépendance des hommes, de leur docilité à accepter et à transmettre une condition qu'elles considèrent comme une fatalité. La mère, la matriarche qui est l'héroïne du livre, est particulière, elle se conforme mais elle exerce aussi un ascendant indéniable. Elle est un personnage hors normes, une sorte de monstre, on le devine dès le début mais on le comprend mieux quand les secrets sont révélés. Elle a une sorte de liberté qui lui est propre, en particulier elle revendique son droit à l'érotisme. Ainsi, la deuxième partie est comme l'envers de la première, ce qui donne un texte à double fond: la narratrice, la fille, s'aperçoit qu'elle vivait sur des malentendus, elle a maintenant comme une illumination, elle entrevoit des vérités. Son voyage à Tunis a été une thérapie, elle s'est "réconciliée" avec sa mère - l'expliciter est l'objet de la courte troisième partie.
On a conclu que c'était un livre intéressant, malgré certaines lourdeurs et longueurs, rachetées par l'humour et par des anecdotes drôles. Si le livre nous parle - en tout cas aux lectrices - c'est parce qu'il donne un décor démesuré, magnifié, presque mythique, à la relation difficile mère-fille, un thème qui concerne tout le monde.
Lundi 7 octobre 2019 : Jean-Philippe Toussaint, "La clé USB"
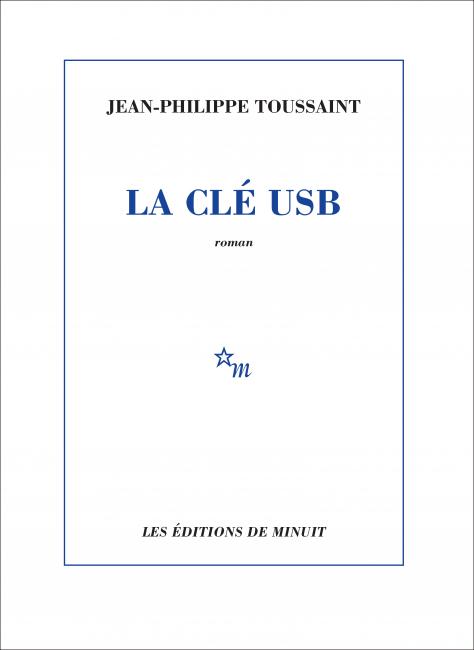
Nous étions neuf dans ma maison de Chissey et nous avons bien discuté du dernier roman de Jean-Philippe Toussaint. nous nous sommes beaucoup amusés. Cette clé usb n'a plus de secret pour nous!
La première page met l'accent sur un blanc dans le temps - les 48 heures passées en Chine dans la "modeste" ville de 7 millions d'habitants, Dalian, et qui ont échappé au monde de la surveillance qui gère désormais nos vies.
Sans doute que le "blanc" se décline dans le roman de plusieurs façons: on pense à l'écriture "blanche" caractéristique de ce récit (celle de Camus dans "L'Etranger", celle de beaucoup des "nouveaux romanciers" publiés par les Editions de Minuit).
On pense au blanc de la page, ou aux "blancs" nécessaires pour rythmer les paragraphes (vous connaissez le célèbre "blanc" à la fin de "L'Education sentimentale" de Flaubert, qui engloutit seize ans de la vie du héros?). Ce blanc est illustré par la perte du texte de la conférence.
On pense encore au blanc du sens, au trou dans le sens, et tout le roman tombe dans ce trou, parce qu'on n'apprend strictement rien qu'on ne connaisse déjà un peu (sur la "blockchain", sur le "minage" et l'armée d'ordinateurs qu'il nécessite, sur le fonctionnement des institutions de Bruxelles et le travail de sape des lobbyistes, et donc sur les espions qui pullulent nécessairement...)
La machine Alpha Miner 88 (page 62-63) n'existe que virtuellement, c'est une machine fantôme: le Narrateur part à sa recherche pour que nous le suivions dans sa quête inutile. Cet objet improbable est ce que Hitchcock appelait un "red herring" (un hareng rouge, un leurre). La fameuse clé elle-même, qui paraît si pleine d'informations, est décevante: jamais on n'a un aboutissement quelconque de la recherche. Au fait, quel est l'objet de la recherche?
Le Narrateur est en fait à la recherche de lui-même. Comme cela a été justement remarqué dans la discussion, le vrai sujet, c'est sa fuite en avant. On sent qu'il traverse une crise, crise qu'il ne se formule pas mais sur laquelle il égrène de petits indices qui sont autant de questions (ses femmes, ses enfants, ses parents, Paris ou Bruxelles? ou l'impossibilité de se territorialiser, ou encore la vie flottante au gré des colloques, dans les avions et les hôtels du monde globalisé, et la "prospective", cette prétention de traiter scientifiquement le futur...)
La maladie du père pèse sur le récit avant même que le voyage commence. Dans un premier temps, les dernières pages peuvent surprendre, comme n'ayant aucun rapport avec le reste du roman. Mais à une deuxième lecture, on voit que quelque chose se dénoue pour le Narrateur. Il commence à se trouver, à sortir de l'écriture blanche, à accepter le désordre, la confusion, l'impureté de la vie, le trouble des sentiments. C'est le retour à l'humain. D'une certaine façon, les étapes du voyage préparaient ce retour à l'humain: l'épisode chinois est incroyablement artisanal, l'usine est un bâtiment délabré et mal gardé, l'hôtel est minable, Internet marche mal, le vol de l'ordinateur, digne d'un numéro de prestidigitateur, est un morceau d'anthologie, le héros court des dangers qui ne se concrétisent jamais. L'épisode japonais apporte sa part d'humanité aussi, très différente, faite de tradition raffinée et de réserve exquise.
"La clé USB" est un roman qui paraît lisse, transparent, peut-être décevant. Mais en fait c'est un vrai objet littéraire, un de ces textes qui font travailler le lecteur!
Lundi 2 septembre 2019 : Françoise Sagan, "Bonjour tristesse" - Anne Garréta "Sphinx"
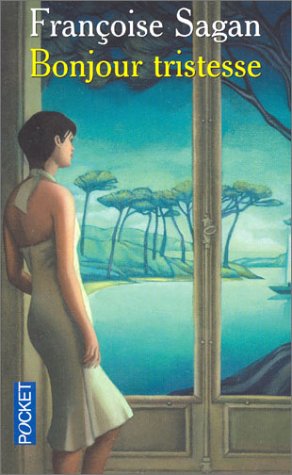 |
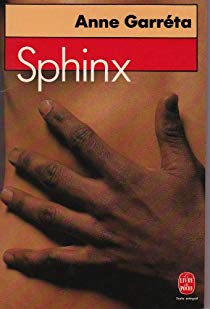 |
Nous avons eu une soirée de rentrée très animée et sympathique chez Nicole Grémeaux, merci à elle! Discussions très inspirantes. "Bonjour tristesse" d'abord. La relecture a suscité un enthousiasme presque unanime. Cécile est-elle manipulatrice? On l'a excusée, c'était un engrenage fatal. Anne s'est-elle vraiment suicidée? Il est facile de rater un virage sur une corniche dans les années 50, et bien des films français ou italiens le montrent, inutile d'aller jusqu'en Californie. Au fait, on n'a pas assez parlé de la vision cinématographique chez Françoise Sagan. On a apprécié son écriture classique: peu de descriptions, observations fugitives qui traquent les affects dans les visages et sous les paroles, amoralité assumée qui rappelle le 18e siècle. Ce roman est un marqueur: il dévoile, avec beaucoup de réalisme, l'hédonisme et la cruauté d'une petite sphère de la société, au sortir de la guerre, et l'énergie qu'elle met à préserver férocement sa bulle. Aujourd'hui cela ne doit pas être très différent.
Le monde léger, facile, ensoleillé, de Sagan semble bien loin du monde nocturne, citadin et glauque de Garréta. Pourtant, il y a des passerelles entre Sagan et Garréta. "Me souvenir m'attriste encore à des années de distance." Voilà un incipit qui est un appel direct à celui de "Bonjour tristesse". Le tragique est inscrit dès le début dans les deux romans, mais il est euphémisé, à moitié désavoué. Puis, les romancières partagent le même goût pour l'imparfait du subjonctif! Il y aurait aussi comme lien, ou personnage transfuge, le personnage d'Elsa: la fille "trash" et paillettes, pauvre mais avide de prendre sa part des plaisirs des riches, et bien en accord avec la vacuité mentale de cette classe qu'elle voudrait rejoindre... La nuit, les rencontres, l'alcool, les boîtes: Sagan connaît aussi.
Si les deux livres ont dérangé, l'un en 1954, l'autre en 1986, c'est aussi parce qu'ils attaquent l'ordre social et la famille - le second de façon plus radicale, certes. Dans "Bonjour tristesse", la "famille" existe encore mais elle est bien ébranlée, et Cécile, en voulant préserver à tout prix le couple indéfinissable mais soudé qu'elle forme avec son père, lui porte un sérieux coup. C'était plus dérangeant à l'époque que le fait qu'elle couche à dix-sept ans avec ce pauvre Cyril, un garçon BCBG.
Côté ordre social et famille, Anne Garréta, elle, écrit sur les ruines d'un monde dévasté. Enfin, s'il tient bon encore, ce n'est pas dans son roman! Et, de façon prémonitoire comme le montrent nos débats actuels et les avancées sociétales d'aujourd'hui, elle s'attaque au genre, elle dynamite la distinction entre masculin et féminin. Elle le fait grâce à un procédé stylistique que le lecteur, la lectrice, a vite fait d'identifier: rien, jamais, ne permet de dire si "Je" et "A" sont un homme ou une femme. Ce procédé renvoie aux jeux du groupe OULIPO, mais ce n'est pas un jeu, c'est une façon d'introduire le malaise dans la langue et d'obliger chacun à s'interroger sur ce que la détermination par le sexe, l'obligation par exemple de cocher M ou F dans un formulaire, a d'intrusif et d'opprimant.
"Sphinx" a suscité nettement moins d'enthousiasme que "Bonjour tristesse". Sans doute parce que le monde très marginal dans lequel il nous introduit semble peu attirant. Ce n'est pas le monde des villas sur la Côte, des téléphones blancs et des belles américaines décapotables. Ce sont les coulisses du Paris nocturne, un monde fermé sur lui-même, incertain et interlope, fragile mais où on se tient chaud (Ferré: "les copains d'la neuille, les frangins de la night"). "Sphinx" est d'ailleurs un document sur le Paris nocturne des années 80, une légende aujourd'hui. (Ecrit au tout début de l'apparition du sida, comme cela a été remarqué dans la discussion, il n'intègre pas ce thème, qui aurait compliqué l'intrigue.)
Certains ont trouvé le roman "froid", en partie à cause du procédé oulipien. D'autres ont senti passer le frisson de la passion malheureuse de "Je" pour le corps "angélique" et fuyant de "A". On a été touché par le chagrin sans fond qui marque les soixante dernières pages, surtout par la visite que fait "Je" à la mère de "A" dans ce sinistre hôpital de New York. "Qui j'ai aimé je l'ai vu mort", dit "Je". Comme Sagan, Garréta ne propose rien mais laisse ouverte la quête du sens.
Lundi 24 juin 2019 : Orhan Pamuk, "La femme aux cheveux roux"
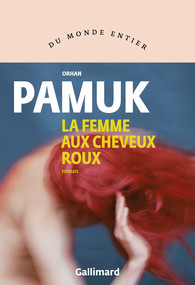
Nous étions douze hier dans le jardin paradisiaque de Chantal ! Et la séance a commencé par quelques brasses rafraîchissantes dans sa piscine.
Puis nous avons plongé dans la Turquie, sujet d'actualité!
Le roman d'Orhan Pamuk a suscité plein d'interventions animées. La plupart ont aimé ce livre, qui a la bonne longueur et où il y a du suspense et des actions. Une ou deux voix étaient moins enthousiastes.
Le romancier fusionne deux mondes habituellement contrastés, il le fait à l'image de son pays qui est un carrefour entre Orient et Occident: son roman est réaliste, il suit des destins de personnages depuis 1985 (et même 1980, puisqu'il y est fait mention du coup d'Etat militaire et de la répression qui a touché des militants de gauche tels que le père du héros) et l'auteur nous mène jusqu'au moment de l'écriture (2015).
Mais Pamuk l'a aussi conçu comme une fable, comme une allégorie des problèmes de la Turquie moderne, et il se réfère pour cela à un mythe qui prend différentes formes - en Grèce, en Perse, dans le Coran, dans la Bible: le mythe d'OEdipe et sa variante inversée, quand c'est le père qui tue le fils.
L'idée soutenue dans le livre, c'est que le malaise des générations successives (depuis Mustafa Kemal Atatürk?) vient des tensions entre les fils et les pères. Ces références s'étendent à la littérature, en particulier Dostoïevski. La tonalité générale (allusivement politique) est plutôt pessimiste, et l'évocation de la Turquie saisie par le boom de l'économie globalisée est satirique.
On peut ne pas adhérer, mais cela n'empêche pas d'être séduit par l'histoire d'amour entre le jeune Cem et la belle Femme aux Cheveux roux, et aussi par l'évocation d'une Turquie aujourd'hui presque disparue, avec ses traditions (le puisatier et son charisme, son côté chamanique) qui rappellent celles du bassin méditerranéen, par exemple Giono. Il y a de belles évocations de la nature, des animaux nocturnes, du ciel étoilé - et puis ce moment magique où Cem fait cette expérience si particulière qu'on appelle "le sentiment océanique".
Une désillusion saisit quand même le lecteur, la lectrice, quand dans les dernières pages nous comprenons que le Narrateur n'était pas celui que nous pensions. On a aussi observé la pression du mythe sur les articulations de l'intrigue: en somme, le romancier suit le schéma préétabli par la fable, schéma qui est plus fort que la vraisemblance psychologique.
Lundi 20 mai 2019 : Michel Butor, "La modification"
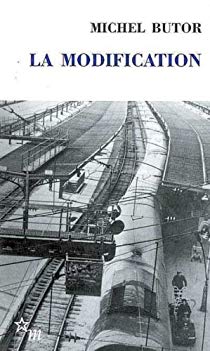
Malgré quelques personnes excusées, nous étions quand même neuf chez Colette et Jean-Philippe, dans leur belle maison de campagne, pour discuter de "La Modification".
Le roman de Michel Butor date d'il y a 60 ans - la plupart le connaissaient ou alors c'était une découverte. Plusieurs l'ont accueilli ou relu avec enthousiasme. L'intrigue est banale, stéréotypée, avec un comique qui relève parfois du théâtre de boulevard. Mais ce qui compte, ce que Butor voulait, c'est qu'on dépasse ce libretto pour s'intéresser au dispositif littéraire qui était innovant. Ce roman est un de ceux qui ont conduit à la formation du groupe du "Nouveau Roman".
Faire tenir la vie d'un individu, tout un monde de pensées, de souvenirs, de projections, de fantasmes, dans un trajet en train Paris-Rome d'environ 20 heures et dans l'espace étroit d'un compartiment de voyageurs de hasard: cela demande une certaine virtuosité. A cet effet, Butor marie des moments de prose poétique (les longues phrases) avec la description minutieuse d'un courant de conscience, et avec une observation des êtres humains qui s'inspire de la psychologie comportementale (effectuée dans un style jugé par certains un peu froid). Son réalisme descriptif nous ramène avec quelque nostalgie aux années 1950, il donne au roman un caractère "historique": il y a des détails qui le "datent".
Le passage entre divers temps et divers lieux est fluide, on peut se repérer. La "modification" s'insinue dans le texte de manière douce mais inflexible. Le voyageur doit choisir entre deux femmes, entre deux lieux: s'il choisit la femme qu'il identifie à Rome et s'il la transfère à Paris, il perdra à la fois Rome et ce qui fait le charme de Cécile.
Parmi les sujets de discussion, il y a eu l'usage que fait Butor du "vous": appel à s'identifier au héros? ou au contraire, mise à distance? Une lectrice peut se sentir interpellée par le romancier d'une manière trop insistante. On a parlé des différences, selon les langues que nous connaissons (italien, espagnol, allemand, anglais), dans la façon de s'adresser à une autre personne...
Lundi 14 avril 2019 : Erri De Luca, "Le tour de l'oie"

Nous avons passé une agréable soirée chez Jacqueline (merci à elle!), nous étions dix, et nous avons discuté du dernier livre de Erri De Luca, "Le tour de l'oie".
C'était très animé, tout le monde a cité telle ou telle phrase ou page, on s'est beaucoup interrogés sur la personnalité si particulière, complexe, à la fois affirmée et évasive, de cet écrivain-poète-philosophe...Par exemple il été militant actif à Lotta Continua pendant les "années de plomb" en Italie (les années 70) mais il refuse d'exercer quelque emprise que ce soit sur les autres.
Ou bien: il écrit ce beau livre plein d'images et de phrases qui suggèrent la sérénité, et pourtant on sent, dans les dessous et la composition du texte, l'angoisse de la mort qui approche.
Il ne regrette pas d'avoir manqué l'occasion d'expérimenter la paternité, mais il est habité par ses souvenirs d'enfance avec son père, et il donne une consistance parfois presque tangible à ce fils qu'il s'invente et avec qui il dialogue pendant une nuit, dans la solitude de sa maison.
Pas d'héritage, pas de transmission: mais ce livre est bien une sorte de testament.
Deux ou trois des lectrices ont eu du mal à entrer dans "Le tour de l'oie". Tout le monde a reconnu l'originalité formelle, le concept, ce dialogue de moi avec moi. A cause du côté fragmentaire et bousculé de cette sorte d'autobiographie-bilan, c'est un livre à lire par petits morceaux, un livre de chevet. Il y a beaucoup de fulgurances - Naples, les langues, la figure récurrente de la mère, l'escalade du Vésuve, la rencontre au zoo avec l'orang-outan... Et à côté des idées, il y a de petits morceaux ramenés du monde sensible, en rapport avec le passé de travailleur manuel de l'auteur, son respect pour les ouvriers et pour les paysans.
Lundi 4 mars 2019 : Oz Amos, "Une histoire d'amour et de ténèbres"

Nous étions hier dans le charmant appartement de Danièle, près de la cathédrale - merci à elle pour son accueil!
Le livre d'Amos Oz - l'histoire de sa famille, de son enfance, de son adolescence, dans la Palestine mandataire et ensuite dans le jeune Etat d'Israël, le tout en 850 pages - a posé un problème à plusieurs lecteurs et lectrices.
Plusieurs se sont arrêtés au bout de 100 ou 150 pages. Certain(e)s sont quand même venu(e)s à la soirée. D'autres qui l'avaient lu, ou pas, se sont excusés. Nous étions huit à discuter de "Une histoire d'amour et de ténèbres". Discussion animée et sympathique, qui a donné l'idée à plusieurs d'y retourner et de finir le livre!
En fait, les 150 premières pages ne sont pas les meilleures. C'est après qu'on accroche et qu'on est porté par le charme du conteur et les flots de son écriture.
Il nous offre un tableau du monde du 20e siècle, vu par le prisme du destin des juifs d'Europe, dans ce minuscule territoire du Moyen Orient où les a poussés le sionisme, un mouvement politique inventé et porté dans les années 1890 par Theodor Herzl. Après la série de pogroms qui a commencé dans l'Empire tsariste dans les années 1880 et qui a déraciné et jeté sur les routes et les mers des centaines de milliers de juifs, ce destin a trouvé une solution (très problématique comme on sait) en deux temps: d'abord avec la prise en compte par la Grande Bretagne en 1917 de la possibilité de créer un foyer juif en Palestine (voir la lettre du ministre Balfour à Lord Rothschild www.lesclesdumoyenorient.com/Declaration-Balfour.html) et ensuite, après la Shoah, avec la création d'Israël en 1948.
Le petit Amos Klausner naît à Jérusalem en 1939, de parents fuyant le nazisme, arrivés en Palestine dans les années 1930. Son érudit de père parle onze langues, sa maman quatre ou cinq. Ils connaissent le yiddish. Entre eux ils parlent russe! Ils n'en transmettent aucune à l'enfant qui est un locuteur natif de l'hébreu. Mais ils ne peuvent l'empêcher d'être un enfant surdoué!
Nous voyons donc par ses yeux ce monde un peu désuet des juifs polonais, russes, allemands, hongrois, autrichiens... transplantés dans un pays inconnu, poussiéreux, vaguement hostile, où ils vivent petitement, dans des cercles cloisonnés, et ont du mal à s'adapter. La mère d'Amos est une victime de cette transplantation. Le fils (qui écrit ses mémoires vers 2000, à 60 ans) lui rend un hommage émouvant à travers le récit qui coule de sa plume, petit à petit. C'est presque par surprise, involontairement, qu'il trace d'elle par fragments un portrait-puzzle. Il nous la rend présente, la jeune femme lumineuse et ténébreuse, modeste et brillante, active et dépressive, qui s'est suicidée quand il avait douze ans. Arrivé au bout du livre, il avoue: "Jusqu'à maintenant, au moment où j'écris ces pages, je n'avais pratiquement jamais parlé de ma mère." (Folio page 836)
Il n'est pas possible de détailler toute la richesse du livre - chacune des lectrices avait ses "morceaux" favoris. Passent des gens pittoresques, célèbres ou pas, et des paysages étranges, des situations souvent drôles, ou ambiguës, ou dramatiques, et de grands moments historiques "comme si on y était". On suit l'enfant qui devient un jeune homme, qui trouve pour plusieurs décennies son "lieu" au kibboutz, qui oublie le nationalisme étroit de ses débuts et bascule dans le camp de la paix, et on entrevoit l'écrivain qu'il est devenu. S'il avait tout raconté, c'est 1500 pages qu'on aurait dû lire!
Vendredi 11 janvier 2019 : François Vallejo, "Hôtel Waldheim"
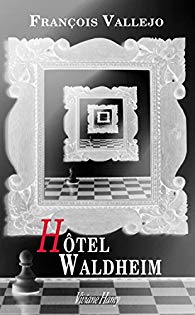
Nous étions onze chez Agnès à fêter notre entrée dans la Nouvelle Année avec le roman palpitant de François Vallejo, "Hôtel Waldheim".
Le livre a été unanimement apprécié, d'autant que plusieurs d'entre nous connaissaient "La Montagne magique" de Thomas Mann qui avait été notre lecture il y a quelques années.
"Hôtel Waldheim" est un roman de l'oubli du passé et du douloureux processus d'anamnèse. Sa construction est un mécanisme d'horlogerie qui s'inspire de deux romans au moins, celui de Thomas Mann (c'est son intertexte affiché) et un autre dont la présence est plus secrète: le roman anglais "Le Messager" (The Go-Between) de L. P. Hartley (publié en 1951 et dont Losey a tiré un film en 1970). Il est à noter que ces deux romans situaient avant la guerre de 14 l'histoire qu'ils racontaient. Dans "Hôtel Waldheim", c'est dans un passé vieux de quarante ans par rapport à aujourd'hui, que les protagonistes doivent retourner en pensée.
C'est dans le décor à la fois feutré, désuet et vaguement inquiétant de la Suisse, dans l'hôtel-sanatorium même de "La Montagne magique", que François Vallejo situe cette histoire sombre qu'il date d'août 1976. Du roman de Mann, le lecteur retrouve l'atmosphère et les paysages - il ne manque que les discussions philosophiques. Quant au roman de Hartley, il fournit la figure du porteur de messages, de l'entremetteur involontaire, un petit garçon dans le livre anglais, un adolescent étranger un peu perdu car parlant mal l'allemand dans le livre français. Le messager est utilisé à son insu dans un imbroglio qui mène à une catastrophe. Chez Hartley la coloration est sociale et sexuelle, chez Vallejo elle est avant tout géo-politique: on est en pleine "guerre froide", et dans ces pays aux confins de l'Est, cette guerre bat son plein.
Jeff est aujourd'hui un Français d'âge mûr vivant en Normandie. Il pensait avoir tout oublié de cet été de vacances où il avait seize ans. En fait, un drame de l'espionnage s'était déroulé à côté de lui, qu'il n'avait pas perçu. C'est une femme suisse, Frieda, qui le confronte avec des archives et des questions, qui essaie de faire de lui un témoin capital, et qui attend beaucoup du retour du refoulé. Elle était alors une petite fille, et dans ce drame elle a perdu son père, un historien transfuge de la DDR qui avait monté en Suisse un réseau pour aider d'autres transfuges, et que la Stasi avait démasqué et (on l'apprend à la fin du roman) contraint à retourner à l'Est.
Le roman de Vallejo déroule lentement cette pelote. Il propose aussi une réflexion sur les procédés littéraires et l'art du roman. Il oblige les protagonistes (et les lecteurs) à la relecture du passé à travers une grille inattendue qui se met en place petit à petit. On peut observer un parallélisme entre Jeff et Frieda: c'est leur fixation sur un stade de l'enfance, leur curiosité pour les parents, pour ce qu'on appelle la "scène primitive". Frieda veut savoir pourquoi son père a disparu en 1976 de Zurich, les abandonnant elle et sa mère. Jeff quant à lui était en 1976 un ado obsédé (comme il est naturel) par les mystères du sexe. Le soir où il s'était fait voyeur pour observer les ébats de ses voisins de chambre (en fait le couple d'espions est-allemands), et qu'il ne s'était rien passé entre eux, sa réaction fut juste de déception, de bouderie - alors qu'il aurait pu ou dû comprendre que ce n'était qu'un faux couple! C'est ainsi, d'erreurs d'interprétation en vérités douteuses, que procède l'enquête qui constitue la fiction.